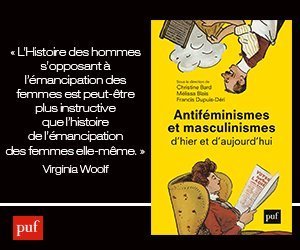Réforme de l’assurance chômage : renouer avec le caractère salarial de la protection
Dans leur discours du 26 février dernier, le Premier ministre et la ministre du Travail ont présenté le système d’indemnisation du chômage français comme devant faire l’objet d’une réforme d’ampleur.
Leur propos était largement centré sur l’objectif de lutter contre les contrats courts en changeant les règles de l’assurance chômage. Deux leviers étant envisagés : « responsabiliser les entreprises » et revoir à la baisse les droits des allocataires qui occupent ces contrats. Or, le passé de l’assurance chômage et des régulations du marché du travail permettent de montrer que ces deux leviers sont voués à l’échec.
Concernant la « responsabilisation des entreprises », si ce discours est resté relativement flou, le projet du gouvernement est connu : il s’agit de mettre en place un système de modulation des cotisations (à la hausse et à la baisse) en fonction de la durée des contrats. Plusieurs scenarii pour réaliser cette modulation ont déjà été évoqués. Quelles que soient les différences entre eux, ils reposent toujours sur le fait de mettre en place une régulation du marché du travail fondée sur une incitation financière. L’idée est double. Premièrement, renchérir le coût du travail pour les contrats courts conduirait à désinciter les employeurs à recourir à ces contrats et à leur substituer des emplois plus stables. Deuxièmement, pour les cas où les employeurs choisiraient le contrat court, la surcotisation viendrait compenser le coût pour la société de ce contrat court.
Les expériences existantes montrent que les effets désincitatifs de ce renchérissement sont très faibles voire nuls. Le recours au travail temporaire présente depuis toujours un surcoût important pour les employeurs, surcoût qui n’a pas empêché un large développement de ce secteur. Il y a des précédents d’augmentation des cotisations patronales à l’assurance chômage pour lutter contre la précarité. Les majorations en vigueur de 2014 à 2017 qui portaient sur les CDD de trois mois ou moins