Quelques remarques sur l’image cinématographique
Il y a deux ans, je fus invité à intervenir à un colloque dont le thème était « La montée des violences ». Y fut projeté un montage d’images de violence réelle ou fictionnelle réalisé par Alain Fleischer. Et dans ce flux d’images de violence, il y avait des images de corps d’animaux pris par les soubresauts, les secousses de la mort. Ce sont des mouvements insupportables à regarder car il ne s’agit pas d’images de fiction, comme le sont les images où nous avons vu des soubresauts joués et même surjoués par des acteurs asiatiques autour de la table lorsqu’ils sont soudainement abattus par des rafales d’armes automatiques.
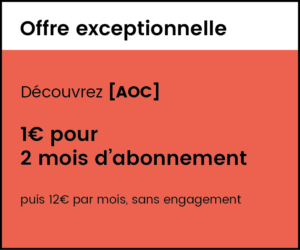
On pourrait même dire que ces acteurs tentent, sans y arriver vraiment, d’imiter la vérité documentaire des animaux qui ne jouent pas, sont là sans conscience fictionnelle. En effet, les animaux, comme aussi les très jeunes enfants, ne sont pas des acteurs capables de jouer, de faire semblant. L’animal vivant réel enregistré par la caméra est une preuve indubitable de présence documentaire pour le spectateur. Ce qu’il voit, ce qu’a vu la caméra, ce que nous venons de voir dans ce film : ces corps d’animaux envahis par les derniers mouvements nerveux, incontrôlés de la vie mise à mort, et en ce sens soubresauts de la mort, ce sont des corps d’animaux réels qui meurent vraiment.
Ces corps qui meurent réellement, dont la mort réelle est filmée, enregistrée, ne sont pas vus par le regard cinématographique, par l’art qu’inventa le cinématographe. Certes, ils sont filmés, certes leur mort est enregistrée en vingt-quatre images/seconde, certes leur prise de vue est opérée par une caméra de cinéma, certes ces images relèvent de la technique d’enregistrement/projection propre au cinéma mais le contrat liant l’œil du cinéaste fixé à cette caméra prenant des vues d’une mise à mort réelle et l’œil du spectateur fixé à l’écran sur lequel sont projetées ces images d’une mise à mort réelle n’est pas le contrat qu’a inventé et transmis le regard cinématographique
