Sciences sociales et action publique
L’histoire des intellectuels, telle qu’elle s’est le plus souvent écrite, est ponctuée par l’engagement de hautes figures dans de grandes causes. De Voltaire aux derniers grands noms des années 1980, l’odyssée des clercs se relate à partir de pratiques où la prise de parole publique s’impose comme le principal levier de l’action. La science y est plus légitimante qu’opérante.
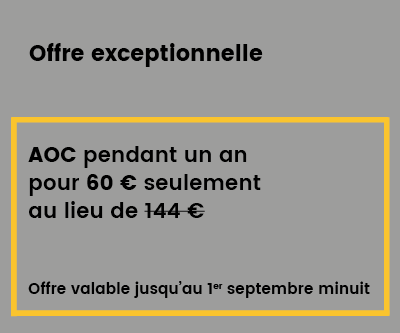
La nouvelle situation faite aux intellectuels, parfois décrite comme une déprise sociale et politique au profit d’un repli sur l’activité scientifique, conduit à réinterroger cette histoire héroïque. Les intellectuels, notamment ceux qui sont issus des sciences sociales, se sont aussi inscrits dans une autre histoire qui les insère dans un rapport négligé à l’action publique. Face à l’injustice, ils ne furent pas seulement les meilleurs agents de l’indignation légitime mais aussi ceux qui s’efforcèrent d’y remédier : pas seulement la harangue de Sartre sur son tonneau mais aussi, par exemple, les austères efforts des philosophes de la République pour bâtir un système scolaire bénéficiant au plus grand nombre.
Nombreux en effet furent les grands universitaires qui se mirent au service de l’État à la fin du XIXe siècle pour élever une République correspondant aux valeurs morales, en faveur desquelles ils affichaient leur faveur. Philosophes, sociologues dans le sillage de Durkheim, à commencer par le maître lui-même, historiens, juristes ne ménagèrent pas leur peine pour donner à la République l’école répondant à son programme où devaient se conjuguer liberté et égalité. La République se développa sur le socle d’une alliance passée entre le droit et les humanités. Dans les allées du pouvoir se fréquentaient professeurs et avocats, et son exercice ne renvoyait pas à une spécialité apprise. Les compétences naissaient de la combinaison de l’expérience et de savoirs puisés dans le trésor de la culture nationale. L’État n’était pas encore « piloté » par une science camérale en bonne et due forme. Seu
