PMA pour toutes : une nouvelle hiérarchie des filiations
Dans cette troisième révision des lois bioéthiques, la question de la procréation médicalement assistée (PMA) est devenue le principal thème du débat public. Cette technique permettant la reproduction sans sexe fut mise en place il y quarante-et-un ans par les gynécologues Patrick Steptoe et Robert Edwars qui ont permis la naissance, en 1978, de Louise Brown premier « bébé éprouvette ».
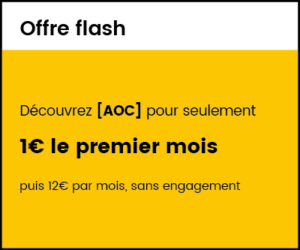
Quatre ans plus tard naissait Amandine, premier bébé issu d’une PMA dans l’Hexagone. Réservée aux couples hétérosexuels en France, la PMA est accessible aux femmes célibataires en Espagne depuis 1988 et aux couples lesbiens depuis 2006 tout comme aux Pays-Bas depuis 2002, au Danemark depuis 2006, au Royaume-Uni depuis 2008, en Belgique depuis 2007, au Portugal depuis 2016, ou encore en Suède depuis 2015. Face aux restrictions de la législation française, les personnes exclues de la PMA n’hésitent pas à chercher hors l’Hexagone la possibilité de concevoir un enfant, poussant ainsi les juridictions nationales dans leurs retranchements et provoquant du même coup l’intervention de la Cour européenne des droits de l’homme.
En affirmant, dans un arrêt de 2014, que le recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger, par insémination artificielle avec donneur anonyme, ne fait pas obstacle à ce que l’épouse de la mère puisse adopter l’enfant ainsi conçu, la Cour de cassation a facilité l’intervention du législateur. Avec la prochaine réforme, la PMA sort du registre de la santé publique pour s’installer dans une dimension civile. Ce changement correspond à une nouvelle « nature » de cette technique laquelle ne trouve plus son fondement dans une pathologie mais dans un projet parental individuel ou d’un couple de femmes. D’un acte médical, la PMA devient ainsi une liberté positive juridiquement reconnue (celle de procréer avec l’aide de la technique) protégée de surcroit par la Convention européenne des droits de l’homme[1].
L’élargissement de la PMA aux femmes célibataires et a
