Révolutionner les sciences pour penser la transition
La transition écologique est à la mode et c’est à qui fera figurer cette expression dans ses discours ou ses textes le plus grand nombre de fois… Les candidat.e.s aux différentes élections rivalisent de propositions et promettent d’être les plus farouches défenseurs de l’écologie. Mais plus rares sont ceux et celles qui admettent que nous avons besoin d’une véritable révolution copernicienne dans nos disciplines, nos représentations et nos modes d’appréhension du monde pour l’engager véritablement et encore plus rares celles et ceux qui ont réfléchi aux nouveaux instruments et à la nouvelle articulation des sciences dont nous avons besoin pour la penser.
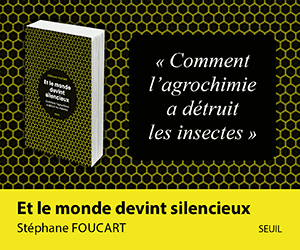
Dans un texte intensément commenté « The historical roots of our ecological crisis », l’historien américain Lynn White avait défendu en 1967 l’idée que notre conception moderne de la science et de la technique avaient joué un rôle fondamental dans la crise écologique en permettant aux humains de mettre le plus rationnellement et le plus efficacement en œuvre l’exploitation de la nature et que c’est à la compréhension – et à la transformation – de cette relation entre humain et nature que nous devrions d’urgence nous atteler. On se souvient en effet du programme de la Modernité clairement délivré par Bacon ou Descartes : le premier dans la Nouvelle Atlantide, publié en 1627, enjoignait aux humains « de connaître les causes, et le mouvement secret des choses ; et de reculer les bornes de l’empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles » tandis que le second, dix ans plus tard, proposait dans Le Discours de la méthode de rompre avec la philosophie spéculative et de se rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature ».
Selon Lynn White, le christianisme est la religion la plus anthropocentrique que le monde ait jamais connu
White s’emploie à démontrer que cette foi nouvelle dans la capacité de la science à connaître et à transformer, à savoir pour pouvoir, vient de très loin, et très précisé
