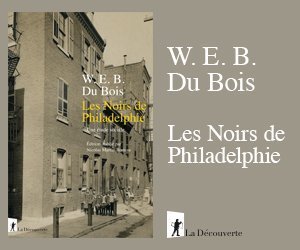Bienvenue dans l’Underworld ou pourquoi le populisme profite de la mondialisation
William R. Burnett (récemment réhabilité par Benoît Tadié chez Gallimard) est un auteur majeur du XXe siècle. Né en même temps qu’Hemingway, la série Noire l’a pipé : elle a châtré ses textes, en a biaisé le genre, les a affublés de noms d’oiseaux. Qu’importe, il finira dans la Pléiade. Nul autre que lui ne porte un regard plus juste, plus perçant, plus intérieur, sur l’Underworld, les marges de la société américaine, là où l’État de droit croise les stratégies personnelles, celles des politiciens, des policiers, des juges, des avocats, des truands. Là où les urbains, les provinciaux de la grande ville, côtoient les immigrés du dedans et du dehors, les enracinés et les nomades, les notables et les anonymes.
Ceux-là sont à 90% blancs, débarqués d’Europe par vagues successives. L’Amérique des années 1950 ressemble à un condensateur, un midwest visqueux coincé entre deux rives perméables, deux électrodes au bord des océans. Burnett explore cette boîte noire, une zone d’ombre où se confondent le bien et le mal, le normal et le pathologique, le légal et l’illégal. La politique, celle du pouvoir, du sexe, du clientélisme, des intrigues du Parti, des manipulations de la presse, transpire de chacun de ses récits. Trump vient de là. De l’Underworld.
Avec Trump, la politique change d’époque. Certes, la crise remonte à 2008, mais ses effets sont différés. Depuis 2011, la croissance mondiale plafonne à 3%. À l’extension rapide des échanges et de leurs gains disséminés dans les États, succède une nouvelle phase marquée par la crise de la dette. La Chine cesse d’être l’atelier du monde finançant ses consommateurs, américains au premier chef. La manne du made in China, des exportations chinoises bon marché, s’épuise face aux inégalités entre acteurs locaux et mondiaux. Il faut rééquilibrer les échanges. Partout, les métropoles ouvertes sur le monde s’opposent aux arrière-pays, moins accessibles aux marchés. La menace climatique dont les causes et les effets se ventile