De quoi l’épigénétique est-elle le nom ?
Il fut un temps où les généticiens annonçaient l’isolement de gènes à un rythme effréné. Combien n’en ont-ils pas découverts ? Le gène des gros, des maigres, des petits, des grands, des homos, des hétéros, des intelligents, des pas intelligents, des schizos, des pas schizos, des malades et des pas malades, etc. Et, à chaque fois, la promesse de comprendre les phénomènes les plus hermétiques ou de guérir toutes sortes de maladies. Pourtant, l’avez-vous remarqué ? Ces annonces se font plus rares.
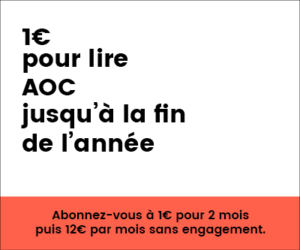
Il y a bien un petit gène de ceci ou de cela de temps en temps, mais on en parle à peine. Comment cela se fait-il ? Les biologistes auraient-ils fini par élucider le mystère du vivant ou bien, sacrilège, travailleraient-ils moins ? Mais non, bien sûr. Au contraire. Récemment ils ont fait une découverte encore plus extraordinaire, une véritable révolution qu’ils appellent « l’épigénétique ». Enfin, c’est ce qui se dit. Alors, de quoi s’agit-il ?
La généalogie du mot remonte au XVIIIe siècle, au débat entre les tenants de la préformation et ceux de l’épigenèse. Les premiers pensaient qu’il existe dans les semences des êtres vivants des répliques minuscules de ceux-ci qui ne font que s’agrandir au cours de l’embryogenèse. La reproduction n’étant donc qu’une affaire de développement quantitatif d’êtres préformés. Les seconds considéraient qu’il se produit, au contraire, une véritable élaboration progressive des parties des êtres vivants pendant le développement embryonnaire.
Les deux écoles ont persisté et se sont affrontées jusqu’à aujourd’hui sous des formes diverses. À la fin du XIXe siècle, la préformation, tout en se transformant, a fait un retour en force avec l’essor de la génétique. En effet, le postulat de cette dernière, à savoir que la transmission de « gènes » contenus dans les noyaux des cellules détermine la transmission des « caractères » des êtres vivants, implique une nouvelle forme de préformationnisme puisque les gènes sont antérieurs à l’être. Certes, il n’es
