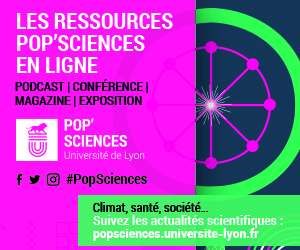San Francisco ou la distanciation sociale avant l’heure
On a ressorti les masques. Le bleu, le rose, le bariolé, taille enfant, achetés pour nous protéger des fumées toxiques du Paradise Fire en novembre 2018. L’air était âpre, piquait les yeux, la gorge. Un brouillard roux à couper au couteau masquait la ville. Déjà, on se calfeutrait et on comptait les morts. Déjà, pendant des jours, on a eu peur de suffoquer.
À l’heure du coronavirus, on retient de nouveau son souffle à San Francisco. Mais aujourd’hui le mal est invisible, partout et nulle part, intraçable. On porte des masques en plein soleil, alors que l’air n’a jamais été aussi pur. Les abeilles sont revenues, les oiseaux s’en donnent à cœur joie. Mais les balançoires des jardins d’enfants pendent dans le vide, inutiles. Les autoroutes qui cisaillent la ville se sont tues. Devant les supermarchés s’allongent des files en pointillé – une personne tous les deux mètres, gants en latex aux mains, et masques déjà obligatoires. La ville est inchangée, la nature resplendit, mais les humains sont sur la défensive, parés pour un cataclysme.
Pourtant, dans la Baie de San Francisco, le nombre de morts n’est pas parti en flèche, comme à New York, en France, en Espagne ou en Italie. La fameuse « courbe » des infections au Covid-19 a été tellement aplatie par des mesures précoces qu’on attend encore « la vague » et le « pic », alors que la côte Est et la Floride ont été submergées.
Mais tout aurait pu être différent. Le 10 mars on recensait quatorze cas d’infection à San Francisco, ville de 885 000 d’habitants, contre seulement sept à New York, qui en compte 8 millions. Un mois plus tard, cette dernière ville est en urgence absolue, littéralement asphyxiée. L’autre attend, immobile. Plus de 13 000 morts à New York au 18 avril contre 20 (en tout) à San Francisco. Pourquoi un tel écart ?
Il y a d’abord sans aucun doute la chronologie – tardive et à reculons côte Est comme en France, proactive en Californie – des politiques publiques. Début mars les rassemblements de plu