L’ombre de l’hydre : pandémies, crise de la biosphère et limites de l’expansion
Une dizaine d’années seulement après le krach financier de 2008-2009, la crise du coronavirus a de nouveau violemment ébranlé l’économie globale. Bien que ces deux crises aient des causes très différentes, elles ont pourtant en commun de mettre en lumière la vulnérabilité et l’instabilité croissante de l’ordre mondial actuel. Un aspect de cette perturbation n’a pas encore suscité l’attention qu’il mérite : le lien entre les pandémies et la destruction de la biosphère, qui progresse à toute vitesse.
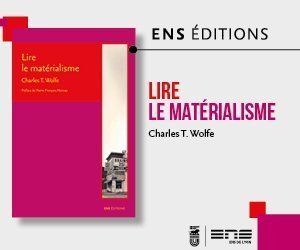
Depuis les années 1970, des agents pathogènes nouveaux ont fait irruption de plus en plus souvent et se sont rapidement propagés dans le monde grâce à la circulation mondialisée des biens et des personnes : le VIH, les virus Ebola et Zika, les pathogènes provoquant les grippes aviaires et porcines ainsi que divers types de coronavirus, parmi lesquels le virus du SRAS et le SARS-CoV-2, responsable du Covid-19. Au moins 60 % de ces nouvelles maladies proviennent des bêtes et, parmi ces zoonoses, deux tiers viennent d’animaux sauvages et un tiers de l’élevage intensif[1]. Le fait que tant d’épidémies modernes proviennent des animaux sauvages tient surtout à ce que leurs habitats sont de plus en plus détruits, notamment par le déboisement des forêts.
Ce processus avait déjà commencé à l’époque coloniale. Au Congo, par exemple, les colonisateurs belges ont fait défricher les forêts pour mettre en place des plantations de caoutchouc et construire des réseaux ferroviaires afin de transporter le cuivre depuis les mines vers les ports. Les macaques expulsés de leur milieu naturel se sont alors introduits dans les agglomérations humaines où ils ont propagé un certain lentivirus, qui s’est peu à peu adapté au corps humain. Aujourd’hui, nous le connaissons sous le nom du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)[2].
De ce point de vue, les pandémies résultent ainsi du projet de domination coloniale moderne. La tentative de soumettre la nature au contrôle humain et la planè
