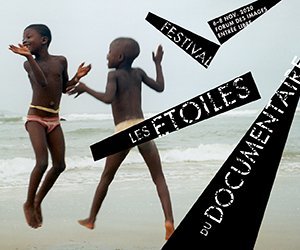De l’urgence d’une transition plurielle
Le mot transition signifie aller vers un au-delà, trans-iter. Il marque le passage d’un état à un autre. Un passage qui peut être brutal ou gradué. Et relever d’états de différente nature : le mot transition peut s’appliquer à la technologie, à l’énergie, à l’écologie, à la politique, et à sa propre intériorité. Évidemment, selon le niveau de temporalité, d’intensité et du champ où s’applique la transition en question, les résultats escomptés ne seront pas les mêmes, ni les processus de sa mise en œuvre concrète.
En écologie intégrale, le mot transition est estimé insuffisant pour certain.e.s, quasiment assimilé à ce que fut jadis le développement durable. Ce dernier, porté à son apogée dans les années 1990, misait sur le découplage possible des flux de matières et de la croissance. En d’autres termes, on pensait possible de maintenir un niveau de croissance élevé sans porter atteinte à la restriction des ressources naturelles, sans détruire les écosystèmes, sans bouleverser le système Terre, avec le seul appui des technologies. Et le tout en réduisant les inégalités. On sait aujourd’hui que c’est un échec radical.
En 2020, jamais les ressources n’ont été autant impactées : à titre d’exemple, en termes de minéraux et pas seulement de métaux avec une surexploitation du cuivre, utile pour isoler les conducteurs ; même le sable est en passe de devenir une denrée rare car nous en mettons partout, de la construction à nos ordinateurs en passant par le textiles (pour l’effet délavé de nos jeans), les verres, les panneaux solaires, les installations sportives, les litières de zoos, les systèmes de freinage etc.
Parallèlement, le fossé des inégalités mondiales n’a jamais été aussi élevé, au point que 10 % des plus riches de notre planète consomment la moitié des ressources de cette dernière. La proportion est simplement inverse pour les plus précaires dont l’impact écologique est très faible non seulement au regard de leur nombre, mais surtout compte tenu des rép