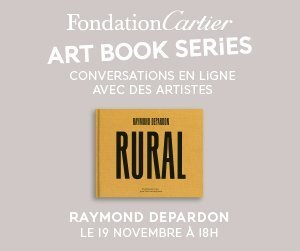De l’existence du décolonialisme
Depuis plusieurs mois, des organes de presse, notamment Marianne et Valeurs actuelles, et des intellectuels médiatiques, au nom de la défense de « notre » laïcité, se font une spécialité de dénoncer l’hégémonie de la pensée décoloniale au sein de l’université française. Il s’agit pourtant d’un mythe dont la fonction, en définitive, est de refuser d’examiner sereinement la crise du modèle républicain à la française et, surtout, d’instiller dans l’opinion l’idée d’une irrémédiable séparation entre « Eux » et « Nous ».
Il serait plus opportun d’analyser les questions que pose le décolonialisme, ne serait-ce que parce qu’elles se nourrissent largement de l’occultation de notre passé esclavagiste et colonial, mais avant tout parce que la critique décoloniale constitue une remise en cause radicale de l’idée même d’universel. Elle constitue donc une mauvaise réponse à la discrimination et à la stigmatisation que subissent les populations dites racisées.
Pour les décoloniaux, modernité et colonialité sont indissociables. C’est la raison pour laquelle, les généalogies sont distinctes : c’est 1492 qui est systématiquement privilégié par ces auteurs[1]. C’est, à leurs yeux, le moment des débuts du capitalisme (et non, comme d’ordinaire, le XVIIIe siècle et la Révolution industrielle) et, surtout, celui de trois faits majeurs : la « conquête » de l’Amérique, la Reconquête des souverains chrétiens sur les musulmans et, enfin, l’expulsion des Juifs d’Espagne par ces mêmes souverains. On remarquera, en passant, que cette période est aussi le passage de l’antijudaïsme classique à l’antisémitisme moderne (même si, bien entendu, le mot n’existe pas encore) par le rôle que jouent les lois de pureté de sang, lesquelles autorisent une irréductible suspicion sur la sincérité de la conversion des Juifs au christianisme.
1492 est ainsi le début du mouvement de substitution de la race à la classe. Ce mouvement est aujourd’hui théorisé par des penseurs influents, très souvent lati