Crépuscule des idoles économiques
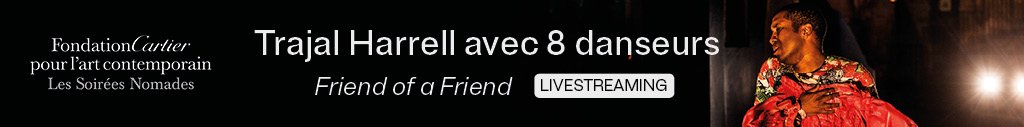
C’est donc reparti pour un tour, à cette nuance près que cette fois, l’effet de surprise passé, la répétition des confinements devrait conduire à réfléchir de façon un peu plus aiguë à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Avec la lassitude et l’horizon indéfiniment repoussé d’une sortie de la crise sanitaire, pourrait finalement s’installer l’impression que cette pandémie et les effets qu’elle a produits ne constituent pas une simple parenthèse mais marquent plutôt l’entrée dans un nouveau moment historique dont les traits se laissent encore difficilement discerner. En tout cas, l’hypothèse d’un retour aux conditions antérieures peut être écartée d’emblée : ce qui a été appris durant cette première année ne va pas s’effacer si facilement. Cette expérience peut s’entendre à la fois comme un avertissement, une mise à l’épreuve et une première esquisse des conditions futures.
Un avertissement
Nous étions prévenus, nous le savons désormais de première main. Depuis les années 1990, le nombre d’épidémies issues de zoonoses progresse régulièrement à un rythme soutenu ; la déforestation des régions subtropicales par des agriculteurs en situation de précarité en est la principale cause. Si les opérations devaient reprendre leur cours ancien après une suspension momentanée, une nouvelle pandémie, peut-être plus létale encore, pourrait toucher en quelques semaines la planète entière. L’exploitation industrielle du monde sauvage et l’accroissement des inégalités ont atteint une limite qui met à terme en danger la survie de l’espèce.
Si l’alarme qu’a déclenchée le virus a retenti plus fortement que des menaces perçues à tort comme lointaines, c’est qu’à la différence de l’effondrement de la biodiversité ou du changement climatique, les décès qu’il produit sont rapides, visibles et clairement imputables. Il n’existe malheureusement pas de test PCR pour identifier en un instant les victimes de la pollution atmosphérique. Pour autant, ce serait une erreur d’oppo
