Pourquoi écrire, quand on a tant à faire ?
Assise sur la banquette moleskine d’un café parisien, Claire me raconte qu’elle a trouvé cet été, en vidant la maison de ses parents décédés il y a peu, un carnet carré dans lequel sa grand-mère consignait les travaux du ménage. Dans cette liste de tâches, un verbe revient sans cesse : blanchir. Blanchir les planchers, les draps, les murs. Blanchir chaque jour et recommencer. Claire me dit que sa grand-mère, fruit d’amours clandestines dans une famille bourgeoise, a été placée dans une famille paysanne en Ardèche, nourrie au sein, avec son frère de lait, aimée et élevée, tout en portant le nom de l’autre famille, celle qui ne la voulait pas.
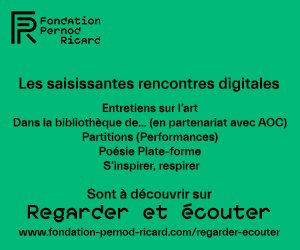
Après son mariage, elle a quitté la ferme pour vivre dans des appartements en ville, des appartements sans suie sur les murs, sans poussière de la terre, et pourtant ces lieux, peut-être dans un effort de réhabilitation de la réputation familiale, elle les blanchit sans relâche. Claire dit : « Pour moi, ma grand-mère, ce n’était pas une femme qui écrivait. »
Marie non plus, ce n’était pas une femme qui écrivait. Et pourtant si, pour elle d’abord, puis pour moi, et pour les autres qui lisent Pas vu Maurice. Chroniques de l’infraordinaire, ce livre construit à partir des carnets qu’elle a remplis de son écriture serrée. Dans son entourage, on ne savait pas non plus qu’elle écrivait, on se souvenait juste qu’elle montait à la chambre, le dimanche après-midi, et n’en redescendait que deux ou trois heures plus tard.
Elle écrit : « seize bocaux de choux-fleurs, dix-neufs bocaux de haricots, seize bocaux de soissons », ou « Laver carreaux, tout balayer, cousu des boutons neufs, chercher choux ». Une fois elle note : « Aucune visite. Beaucoup écrit. ». C’était ma voisine, dans ce hameau déserté des monts du Forez où je suis venue vivre, enfant, dans les bagages de ma mère hippie qui avait choisi le retour à la terre.
Je connaissais Marie depuis l’enfance, mais je n’ai connu ses carnets qu’après sa mort, parce que l’homme qui
