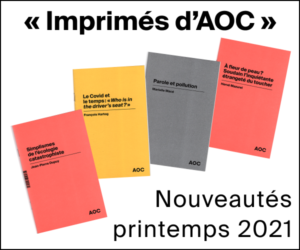Cancel Culture : la censure euphémisée
L’extrême-droite assume. La censure, notamment des œuvres d’art, n’est pas un mot qui lui fait peur. Elle la réclame, elle l’a pratiquée quand elle était aux commandes de certaines municipalités (souvenons-nous de Vitrolles !) sans aucune forme de pudeur. Lorsqu’elle monte à l’assaut pour réclamer la censure d’une œuvre, elle soulève des troupes qui n’ont cure de voir l’œuvre dénoncée, et reprennent en chœur les reproches, en général moraux, énoncés par les chefs : heurt des convictions, des croyances ou bien, de façon opportuniste, protection de la sensibilité des enfants dont elle se fait une conception toute particulière. Réclamer la censure est une façon, pour l’extrême-droite, de mener sa bataille culturelle, et de faire advenir son vieux rêve de régenter le monde du visible et du sensible.
Ses thèses et ses pratiques auraient-elles gagné en ampleur ? Auraient-elles contaminé des mouvements qui ne partagent en aucune manière ses thèses ? C’est ce qui nous inquiète.
Depuis 2009, de nouveaux acteurs réclament la censure d’œuvres que, jusque-là, seule l’extrême droite et quelques associations familialistes proches de ses thèses attaquaient. Avec la mobilisation de cinq organisations féministes contre le chanteur Orelsan, un verrou saute, celui de l’incompatibilité entre l’appartenance au camp progressiste, terreau habituel du féminisme, et la revendication de censure contre des œuvres ou des artistes. À ce type de mobilisations s’ajoutent de nouvelles organisations anti-racistes réclamant à leur tour des interdictions de diffusion d’œuvres devant les tribunaux, ou organisant des campagnes pour faire annuler sans décision de justice des spectacles, des films, des concerts, etc… Ceux-là n’assument même pas être devenus des censeurs.
Aussi est-il nécessaire de nous interroger sur les motivations de ces nouveaux acteurs d’une censure euphémisée, sur la cohérence entre leurs actions et leurs convictions ; et, puisqu’ils le contestent, sur la pertinence du terme même d