Pour un usage social des biens confisqués à la criminalité organisée
Dans le cadre de la loi du 8 avril dernier visant à améliorer l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, l’article 4 vise à autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à mettre à la disposition de certaines associations, fondations d’utilité publique ou organismes qui concourent à la politique du logement, des biens immobiliers saisis ou confisqués dans le cadre d’une procédure pénale.
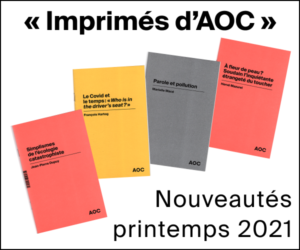
Déjà approuvée par le Sénat en 2019 à l’occasion de l’examen d’une précédente proposition de loi [1], cette mesure fait suite à une série de tentatives visant à inscrire dans le droit français des dispositifs, calqués sur le modèle italien, d’usage social des biens confisqués à la criminalité organisée. Pour saisir la portée et les limites de cette actualité législative, il faut revenir sur le cas italien, précurseur en la matière.
Les réseaux criminels sont devenus une puissance économique indissociable du capitalisme. Ils disposent, en effet, des capitaux et des liquidités indispensables à sa viabilité. Très prospères sur les marchés de la drogue, de la prostitution, de la vente d’armes et des contrefaçons, ils s’étendent également à la finance internationale par le biais du blanchiment d’argent et du recyclage de capitaux, ainsi que par la corruption des marchés publics.
Plus généralement, tous les secteurs présentant un fort potentiel de gains peuvent être investis par la criminalité, par le biais de « zones grises » de complicité et de connivence. Il s’agit d’espaces à la frontière entre légalité et illégalité, dans lesquels criminels, responsables politiques, entrepreneurs et fonctionnaires nouent des alliances et échangent des faveurs : les réseaux criminels offrent protection, intermédiation et capitaux aux acteurs économiques et professionnels ; en échange, ceux-ci offrent des compétences dont la criminalité est dépourvue.
Par ce biais, des capitaux illicites sont investis dans les marchés et la cri
