La gestation pour autrui et le gouvernement juridique des corps
Absente de la révision des lois de bioéthique, la GPA est omniprésente dans le débat public : désignée comme une forme de marchandisation du corps humain, contraire à la dignité de la femme pour ses opposants, elle est justifiée, par ses partisans, comme une réalité incontournable à laquelle il faut répondre par l’inscription des enfants nés par GPA à l’étranger.
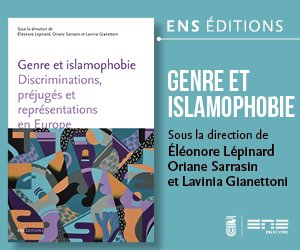
C’est cette position minimaliste qui a été adoptée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) lorsqu’elle a condamné la France pour refus de transcription, au nom du droit au respect de la vie privée des enfants.
Afin d’essayer de comprendre l’hostilité envers une pratique procréative autorisée dans plusieurs pays démocratiques et plébiscitée par l’opinion publique française [1], il nous paraissait opportun d’organiser un colloque dont un ouvrage Penser la GPA en est désormais le fruit. Il est impossible d’exposer ici les différentes analyses des intervenants sans trahir la complexité de leur pensée. Nous nous limiterons à présenter brièvement certaines conclusions provenant de nos chapitres respectifs.
Si nous n’étions pas tous d’accord sur l’opportunité d’autoriser la GPA, nous coïncidions cependant sur la nécessité de poser les termes d’un débat apaisé, loin des peurs et des caricatures que les mères porteuses peuvent susciter. La situation est d’autant plus urgente qu’une entreprise intellectuelle s’est mise en place dans l’Hexagone, à coups d’arguments d’autorité, dans le but de soustraire de la délibération démocratique cette forme de procréation.
Tout d’abord, il s’agissait de replacer la question dans sa dimension historique. Dans l’Ancien Testament, Abraham apparait comme le premier commanditaire d’une GPA : sa femme Sarah étant stérile, c’est son esclave Agar qui lui fera un enfant pour assurer sa descendance. Dans la Rome antique, un citoyen, dont l’épouse était féconde, pouvait la céder à un autre, dont la femme était stérile. L’enfant né de cette union charnelle temporaire ét
