Ne rouvrons pas les mêmes musées
Il est, à l’autre bout du monde, un chapelet d’îles. J’y ai défait mon sac il y a quelques années, loin du tumulte, prenant pour asile, à l’orée de ce territoire marin, une maison ancienne sur laquelle veillaient deux discrètes figures d’ombre.
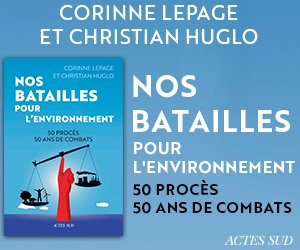
Graviers, buis taillés, bassin d’eau claire, et un pin aux branches torves devant une lanterne de granit ; huit tatamis comme mesure de l’espace où s’enclore ; l’encoche usée de deux solives pour y faire glisser nuitamment les shoji ouvrant ou fermant l’alcôve au jour.
Devant ce belvédère, l’horizon : un unique plan de brume, gris, sans modulations, impalpable mais résolument occultant les jours de pluie – et l’idée, alors, de rien d’autre que d’un air saturé de gouttelettes en suspension – ; toute la profondeur d’un paysage immense, comme infini dans la répétition de ses parties lorsque, la pluie retirée, réapparaissaient au loin les îles vertes et la mer entre elles étagée, claire ou sombre selon les heures. Le soleil enfin, souvent variable, éclatant parfois, invisible à d’autres moments.
Au bord de la mer intérieure du Japon, le paysage s’offre en plans successifs. La dilatation et la rétractation de l’espace s’imposent au fil des jours et des variations de l’atmosphère. La déambulation y prend les allures du ressac. D’île en île, d’un ferry à l’autre, le parcours n’est jamais linéaire. Il faut se rendre ici pour accéder là ; revenir d’où l’on était parti pour prendre une autre liaison ; avancer et reculer, repartir dans une autre direction, progresser par petits bonds.
Il faut aussi savoir renoncer : pas de bateau aujourd’hui, demain non plus. Quand donc ? Qui sait. Reste le plus souvent à obliquer. À abdiquer et s’avouer fragile : non pas incapable, au sens propre du terme, mais tenu par des éléments que l’on ne saurait maîtriser. Reprendre le fil du ressac, et se laisser porter.
Ce mouvement est un dépouillement. Aller, venir dans un espace immense ou resserré, agrandi ou soudain opacifié, sans toujours savoi
