Sciences et croyances autour d’un vaccin
Il est commun de distinguer les savoirs scientifiques et les croyances. Pour valider une position, la référence à une rationalité et une méthode éprouvée d’investigation et d’expérimentation est souvent opposée aux croyances, jugées irrationnelles, qui induiraient en erreur à partir d’idées préconçues.
Ce modèle est précisément reproduit autour de la vaccination contre le virus du Covid. Le positionnement « pro-vaccin » s’effectue ainsi en référence à un savoir et à des faits scientifiques que les « anti-vaccins » manqueraient de saisir, embourbés qu’ils seraient dans leurs prénotions, à savoir leur spontanéité voire leur ignorance.
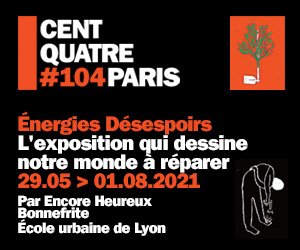
De la sorte un dualisme, sciences = confiance versus croyances = méfiance, émerge et paraît au cœur des débats actuels. Il ne s’agit pas de faire ici un inventaire des arguments pour ou contre le vaccin mais s’arrêter un instant sur la structure de pensée qui régit les options prises en la matière. Cela suppose un petit retour sur ce qui se joue vraiment dans le rapport commun aux sciences et aux croyances.
À la question « à qui se fier ? » chacun répondrait sans doute : les gens bien informés. Mais comment les reconnaître ? Le corps scientifique ne parle pas d’une seule voix ; il expose ses controverses et cela déconcerte le grand public, peu au fait des désaccords scientifiques, pourtant courants.
Les approches scientifiques, rappelons-le, visent, de façon méthodique, à mieux comprendre et à acquérir des connaissances à travers l’étude de faits et de relations de cause à effet, fondées sur la mise à l’épreuve d’hypothèses par l’observation et l’expérience. Un ensemble d’étapes à suivre, consignées dans un protocole, sont nécessaires pour établir des résultats objectifs offrant des conclusions admissibles par les pairs lorsque des avancées identiques, effectuées par d’autres équipes, conduiront à des résultats comparables, qui constituent en quelque sorte des preuves temporaires. En ce sens, les sciences sont à l’opposé de l’o
