Brassens et son public : un malentendu créateur
À y regarder de près, on s’étonne du contraste existant entre l’image convenue d’un Brassens incarnant le « chanteur engagé » par excellence, soutenu avec le dernier enthousiasme par un public largement composé d’enseignants votant à gauche, et les textes de certaines chansons où se dévoile une culture politique d’une autre nature.
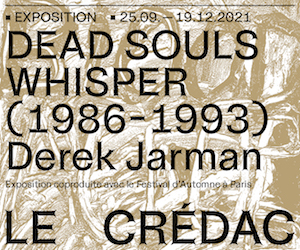
Sans trop risquer l’anachronisme qui accuse aujourd’hui plus que jamais cet aspect du répertoire de Brassens, on peut souligner quelques traits qui, au temps même de la création de ces chansons, ont heurté ou gêné ses plus fidèles soutiens. Le pacifisme relativiste des Deux oncles, renvoyant dos à dos l’ami des tommies et celui des teutons, en 1964, l’année même de la retentissante panthéonisation de Jean Moulin, les moqueries virilistes visant les homosexuels (Les trompettes de la renommée, 1962) que rejoint une misogynie de corps de garde tempérée d’hommages à « la femme » sévèrement jugés par le féminisme contemporain (Misogynie à part, 1969), voire la perplexité narquoise affichée en 1972 dans Mourir pour des idées (« d’accord mais de mort lente ») ou un individualisme radical qui conçoit le « pluriel » comme une perpétuelle menace (« Le Pluriel ne vaut rien à l’homme », Le Pluriel, 1966) dans un moment historique – les années 1950-1970 – où l’engagement était théorisé à tout va.
Dans les innombrables interviews au cours desquelles Brassens commente son œuvre, le chanteur ne fait jamais mystère de l’esprit qui gouverne son art. Avec une certaine obstination, il s’emploie à réfuter la figure de l’artiste à messages qu’on voudrait reconnaître en lui.
Un vif désaccord, qui n’excluait pas l’estime réciproque, l’opposa ainsi à Jean Ferrat, compagnon de route du Parti communiste très enclin à défendre la figure du chanteur engagé. Pour Brassens, la fabrique des chansons n’est soumise qu’à la seule commande des émotions et ne suit d’autre exigence que celle que lui impose la langue la plus adéquate soutenue par la musique la plus a
