Gdańsk : fièvre patrimoniale, conflit mémoriel
Chaque été, et chaque année un peu plus, les médias font écho aux travaux du Comité du Patrimoine mondial. Il y a là un signe indiscutable de l’intérêt croissant manifesté pour la Convention correspondante, conçue et gérée par l’UNESCO depuis 1972, et le « label » qui, aux yeux de beaucoup, vaut reconnaissance pour un nombre de « biens » toujours croissant.
Ceci dit, l’écho donné à ces travaux est très sélectif : l’attention des médias se concentre presque exclusivement sur les biens nouvellement inscrits dans le pays qui leur correspond, les publications se contentant le plus souvent de se joindre au chœur de ceux qui, au moment d’une inscription, communient dans un sentiment de fierté locale et nationale.
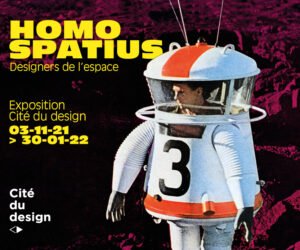
L’édition 2021 – la 44e session – n’a pas échappé à la règle : les médias français se sont réjouis de l’inscription de Vichy et de Nice sans trop s’attarder sur la nature des propositions et des débats auxquels elles ont donné lieu. En l’occurrence, quitte à refroidir un peu les émois de l’autocélébration nationaliste, Vichy a été inscrite au titre d’un « bien en série » associant une dizaine de stations thermales européennes et célébrant d’abord et avant tout un héritage continental ; et Nice a été inscrite, contre l’avis des experts chargés de l’évaluation des candidatures, grâce à une coalition d’États membres du Comité jouant de leur savoir-faire diplomatique pour satisfaire la France.
L’écho donné à la procédure d’inscription au Patrimoine mondial est donc autant tourné vers la célébration des « labels » décrochés qu’indifférent aux conditions et modalités de leur attribution. Seule exception à cette couverture sélective de la session 2021 du Comité du Patrimoine mondial, la presse française a fait état de la désinscription d’un site – le « port marchand de Liverpool » – décision rare qui ne s’est produite que 3 fois dans l’histoire de la Convention. Mais elle a privilégié la voix scandalisée des élus de la ville et du Royaume-Uni, ceux-ci faisant
