Des propositions ineptes contre la Cour européenne des droits de l’homme
Depuis quelque temps, le trait est systématique : dès qu’une élection approche, la Cour européenne des droits de l’homme s’invite bien malgré elle dans le débat politique. Les attaques frontales à son endroit se répètent et gagnent en intensité. Elles s’inscrivent dans un contexte général de remise en cause des droits de l’homme.
Les discours critiques à l’égard des droits de l’homme ont le vent en poupe. Il suffit de consulter les essais parus récemment sur la question[1]. À en croire leurs auteurs, les droits de l’homme seraient responsables des maux français : immigration massive ; montée du terrorisme ; dilution du politique ; hypertrophie des droits subjectifs au détriment de l’intérêt général… Mais, comme l’a montré un récent colloque organisé à l’Université Panthéon-Assas par Édouard Dubout et Sébastien Touzé[2], ces critiques ne visent pas tant l’idée de droits de l’homme que leur usage, leur mise en œuvre et les solutions dégagées par les différents juges.
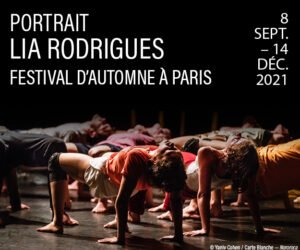
La Cour européenne des droits de l’homme, juridiction supranationale protectrice des droits de l’homme, fait figure d’accusé idéal : « tout semble fonctionner comme si la jurisprudence de la Cour est devenue le catalyseur des anti-lumières et des mouvements apparentés, réactionnaires, nationalistes, identitaires, traditionalistes et autres conservateurs… En effet, la Cour cumule à elle seule deux handicaps majeurs. Premièrement, elle protège les droits de l’homme jugés obsolètes. Deuxièmement, elle est européenne c’est-à-dire supranationale. Dans les deux cas, le désamour qui frappe le système conventionnel est révélateur de maux plus profonds, le recul de l’État de droit d’une part, celui de l’ouverture et du cosmopolitisme d’autre part »[3].
L’expression Cour européenne des droits de l’homme serait-elle devenue obscène ? À la faveur d’un regain du souverainisme, voire même d’un certain nationalisme juridique, l’on voit donc fleurir régulièrement des propositions visant à sortir de la Conventio
