Portrait du capitaliste en auteur de science-fiction
L’année 2021 a été une année marquée par la science-fiction, mais peut-être pas là où l’on attendait forcément. Pourtant, ce n’est ni au cinéma – malgré le succès de l’excellent[1] Dune de Denis Villeneuve – ni même dans l’empreinte laissée par la pandémie – qui a donné à plus d’un l’impression de faire un bond soudain dans une dystopie – qu’il faut chercher les traces de la SF : non, c’est dans les discours des grands milliardaires qu’elle a été, peut-être, le plus présente et, en tout cas, la plus marquante.
Jeff Bezos ne s’est pas contenté de réaliser le premier vol de tourisme dont tant d’auteurs et d’autrices avaient rêvé avant lui : il a aussi promis la constitution de vastes colonies spatiales sous la forme de cylindres géants suspendus dans le vide interplanétaire – une image certes venue des prédictions de la NASA mais que l’écrivain William Gibson avait déjà utilisé dans son séminal Neuromancien.
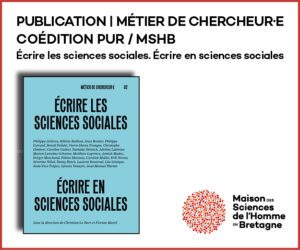
Mark Zuckerberg, de son côté, s’est non seulement lancé dans la création d’un univers parallèle numérique, mais il en a emprunté le nom qu’il lui donne, « métaverse », au Samouraï Virtuel, roman culte de Neal Stephenson. Et que dire de Elon Musk, sacré « personnalité de l’année » par le Time, si ce n’est qu’il s’est constitué une image publique digne d’un personne de Philip K. Dick ? Lui aussi se présente volontiers comme un adepte de la littérature science-fictive, citant notamment le Fondation d’Isaac Asimov et le Révolte sur la lune de Robert Heinlein parmi ses livres préférées.
Ce goût des hérauts du capitalisme pour la science-fiction a de quoi étonner. S’il serait exagéré de dire que le genre est par essence critique, on peut néanmoins souligner, avec d’autres, que bien des œuvres qui y sont considérées comme majeures n’ont pas été avares de critiques vis-à-vis du capitalisme.
C’est d’ailleurs de façon marquante le cas de bien des œuvres auquel le trio de milliardaires précédemment cité fait des emprunts : le cyberpunk dont relève les œuvres de Gi
