Pneumatopolitique (ce que conspirer veut dire)
«Conspiration » (conspiracy en anglais) : voilà certainement l’un des mots – ou l’un des fantasmes – les plus partagés aujourd’hui. Dans son acception moderne (comme quand on parle de « thèses conspirationnistes » ou de conspiracy theory), il n’a pas seulement envahi la médiasphère dans laquelle nous vivons et respirons : il a également recouvert (il faudrait peut-être dire refoulé) son sens ancien.
Ce sens oublié est celui que Andy Warhol avait ressuscité en 1969 sur une affiche lithographiée annonçant une exposition au profit des Chicago Seven (un groupe de militants contre la guerre du Vietnam, accusés par le gouvernement fédéral de conspiration). On peut y lire ceci : « conspirer veut dire respirer ensemble » (conspiracy means to breathe together).
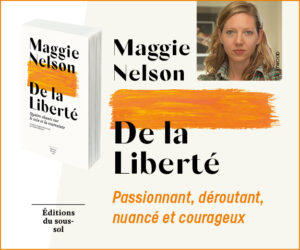
Dans les remarques qui suivent, j’aimerais prêter l’oreille à ce que ce sens enfoui peut nous promettre, à la manière d’un futur-dans-le-passé. Réapprendre à écouter ce qu’il y a de co-inspiration dans la conspiration, c’est certainement un geste archéologique. Mais puisque cette fouille ou excavation vise à creuser pour ainsi dire en l’air – puisqu’il s’agira d’exhumer quelque chose de caché dans ce que nous imaginons (à tort) comme le plus immatériel (ou le plus subtil) des médiums, à savoir l’atmosphère –, on pourrait aussi la décrire comme un geste anarchéologique : une sorte d’archéologie renversée ou sens dessus dessous, dirigée vers le haut[1].
La possibilité même de respirer – et de respirer ensemble – n’a peut-être jamais semblé aussi fragile qu’aujourd’hui. Nous vivons depuis deux ans une pandémie charriant son lot de masques respiratoires et de respirateurs artificiels (ainsi que nombre de théories du complot concernant la vaccination).
Le mouvement Black Lives Matter a témoigné des pratiques policières racistes ayant recours aux prises d’étranglement. Et, après la brève parenthèse due aux divers confinements, les pics de pollution reprennent de plus belle, renouant avec la désormais longue hist
