Jouissance cognitive et jeu électoral : fin de partie ?
Nature humaine et addiction cognitive
Avant d’en venir au jeu électoral, commençons par poser les données anthropologiques. La vie animale, dont participe l’être humain, est régie par le système biologique des récompenses chimiques. L’animal, pour faire face à la nature où il est immergé et pour réagir efficacement au cours des multiples interactions qu’il a avec son environnement, doit constamment mettre en œuvre ses capacités cognitives et il en est récompensé, non seulement en parvenant à surmonter ces difficultés imprévisibles et toujours renaissantes, mais par les « récompenses chimiques » qui sont produites naturellement par son appareil neuronal et dont les plus connues sont la dopamine, la sérotonine ou l’endorphine.
Ces capacités sont vitales pour l’animal et il passe donc la première phase de sa vie à les développer, grâce à des phases de jeu pendant lesquelles, sous la surveillance d’adultes (la mère, le plus souvent), il a pu s’exercer en toute liberté et jouir de cette insouciance ou optimiser ces capacités. Mais cette pure jouissance, éprouvée à l’écart des interactions dangereuses avec la nature, cesse avec l’autonomie de l’âge adulte. L’animal est alors lancé dans la vie réelle ; ses plaisirs, aussi intenses soient-ils, seront désormais limités du fait même des menaces ou des difficultés qu’il rencontre à chaque moment de son existence.
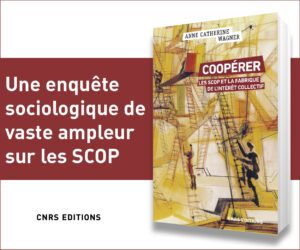
Ce système de récompense neuronal, l’être humain le partage à peu près totalement avec le reste des mammifères. En revanche, il est le seul animal auquel son évolution phylogénétique a appris à déconnecter le plaisir cognitif de sa fonction vitale. C’est par exemple ce qui lui permet de rire : face à quelque chose d’incongru, qui pourrait l’inquiéter, il éclate de rire, parce qu’il sait qu’il n’a rien à en redouter, comme si une frontière invisible et infranchissable le séparait de l’objet de son rire, comme s’il était capable de se déconnecter de son environnement et des menaces qui peuvent en surgir.
C’e
