Des gauches sans possibles ?
La campagne pour l’élection présidentielle française illustre une fois de plus l’état de fragmentation et de décomposition des organisations politiques rattachées aux gauches. Elle témoigne aussi de la puissance inquiétante acquise par les thématiques portées par l’extrême-droite.
Pour rendre compte de ce nouveau rapport de forces entre partis et entre cultures politiques, les facteurs matériels et organisationnels occupent une place prépondérante. La crise des organes d’expression des forces de gauche, l’éloignement social, politique et éthique de ses représentants vis-à-vis des groupes qu’ils représentaient, le financement et la démultiplication des titres de journaux, de revues et des chaînes promouvant les idées de droite et d’extrême droite, les transformations de l’actionnariat des médias, en sont, parmi d’autres, des causes essentielles.
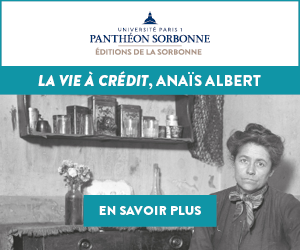
Crises de la critique
Les facteurs intellectuels de cette transformation de l’échiquier politique dont nous sommes souvent les spectateurs atterrés ne sont pas pour autant négligeables. Parmi eux, il y a la distance voire la défiance, y compris à gauche, entre les professionnels de la politique et les idées des mouvements sociaux et intellectuels.
De la contestation néo-conservatrice des savoirs critiques, en vogue actuellement en France, au mépris des universités au plus haut niveau de l’État, en passant par l’usage intermittent ou instrumental des sciences pendant la pandémie actuelle et pendant les campagnes électorales : plusieurs épisodes récents viennent rappeler la dévalorisation, dans le monde de la politique et parmi les formations d’extrême-droite, de droite mais aussi de gauche, des idées rigoureusement contrôlées ou discutées, de celles et ceux qui les font vivre. Peut-on prétendre améliorer ou réparer le monde si l’on n’est pas vraiment attentif aux idées nouvelles et à leurs conditions matérielles et socio-économiques d’élaboration ?
Dans les universités et les laboratoires, c’est aussi la fragmentatio
