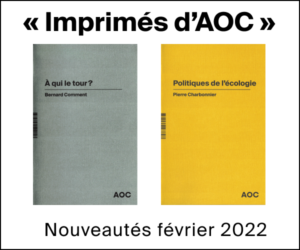Des campagnes pas si mal habitées
Où habiter, comment, à quel prix ? Notre logement en dit beaucoup sur nous, notre position sociale, notre pouvoir d’achat, notre santé, l’éducation que nous pourrons donner à nos enfants, notre accès aux services publics, sur les inégalités, l’aménagement du territoire, la mobilité, la transition écologique, nos façons d’habiter et donc de vivre, chez nous et avec les autres…, sur une certaine capacité à maîtriser notre vie.
La pandémie qui nous a tous tenus enfermés, chez nous, nous a montré les possibilités et les limites de ce refuge. Ce sujet, politique s’il en est, ne devrait-il pas être la pierre angulaire de tout programme électoral ? Il n’en occupe généralement qu’une petite partie, souvent à la fin. Même si l’élection n’est pas une posture ni la campagne une liste de courses, même si de grandes mesures sont parfois nées hors des contextes électoraux, comme la loi SRU, la baisse des APL ou des réorganisations territoriales, il est instructif et parfois surprenant de regarder de près quelles promesses de campagne ont été suivies d’effet, ont changé, et changeront, vraiment, la vie des gens[1]. Remontons le temps…
Il y a les souvenirs, et il y a les archives. Et pour être précis en politique, faire confiance aux secondes aide à dépassionner les premiers. Le logement, sujet essentiel, quotidien pour tous, serait, nous dit-on tous les 5 ans, le grand absent des campagnes présidentielles. Vrai ou faux ? Le logement est moins (bien) traité que la sécurité ou l’immigration, cela ne semble pas faire de doute. L’est-il moins que l’agriculture, l’éducation ou la santé, questions toutes aussi essentielles ?
Un petit plongeon arrière, jusqu’en 2002, permet d’analyser les propositions des uns et des autres, de tous les candidats présents au premier tour, d’observer lesquelles ont disparu parce que traduites dans la loi puis mises en œuvre, lesquelles ont été portées et par qui, lesquelles restent en suspens, lesquelles émergent pour répondre à de nouvelles questions.
N