En Russie, la potentialité émancipatrice du peuple
À l’heure où, notamment en Russie, le populisme est accusé de mêler sciemment la dimension sociale et la dimension ethnique du « peuple » au point de les rendre indissociables, afin de laisser croire en une homogénéité de la nation soudée face à ses ennemis et solidaire des manœuvres guerrières de ses dirigeants, l’étude du populisme russe apparaît politiquement salutaire : elle permet de contester la confiscation de l’histoire et de la diversité du peuple russe par le pouvoir actuel, en pointant l’existence de traditions radicalement opposées au prétendu « populisme » poutinien et en rappelant qu’il existe derrière les tsars et leurs héritiers un peuple russe pluriel, potentiellement hostile à ses maîtres et susceptible de se mobiliser.
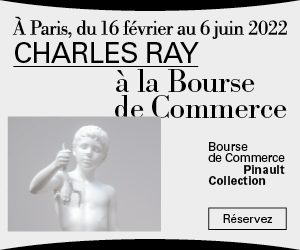
De ce point de vue, si les guerres extérieures sont évidemment pour les autorités un moyen de redorer un blason affaibli par les difficultés internes, elles peuvent également être à l’origine de vastes mobilisations populaires. Et c’est particulièrement vrai en Russie si l’on se rappelle 1905 et, bien évidemment, 1917.
Le mouvement populiste russe, qui a secoué l’empire des tsars pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, fait figure de grand absent dans la masse considérable d’articles et d’ouvrages consacrés au phénomène populiste[1]. Et de fait, le phénomène a peu à voir avec ce que l’on considère habituellement comme les phénomènes populistes typiques, qu’il s’agisse du populisme dit « de gauche » – le péronisme argentin, la tradition populiste nord-américaine – ou du populisme « de droite », incarné par des dirigeants tels que Trump, Poutine ou Bolsonaro. D’ailleurs, l’unité lexicale du terme « populisme » est en partie un leurre : la langue russe distingue le terme désignant le phénomène spécifiquement russe – narodnitchestvo (de narod, le peuple) – du populism, néologisme calqué sur le terme occidental et servant désormais à désigner les réalités actuelles.
Populisme et démagogie
Le populisme contemporain se dé
