Partenariats public-communs : entre rapport de force, politisation et insurrection du droit
Voilà plusieurs années que le mouvement des communs pose la question des partenariats public-communs (PPC dans la suite du texte) sans pour autant parvenir à en instituer les formes juridiques, ni à consacrer les nécessaires changements culturels et le portage politique qu’ils nécessitent.
Alternatives au dévoiement des partenariats public-privé (PPP), irruption de l’agir citoyen dans les territoires, ouverture d’une troisième voie entre puissance publique et forces économiques privées, renouvellement des postures et de la fabrique des politiques publiques : les PPC relèvent encore plus du mot d’ordre que d’un nouveau régime de légalité et d’un changement de culture de l’action publique. En somme, on voit bien de quoi il s’agit en théorie mais difficile de mettre la main dessus en pratique…
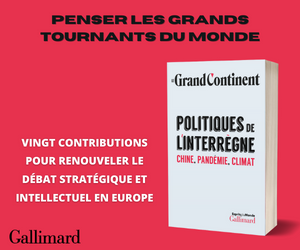
Dans le dossier de la revue Horizons publics[1] que nous avons consacré à cette question, nous avons voulu mener l’enquête en sollicitant ou interrogeant des penseurs, acteurs et alliés des communs. La richesse de leurs réflexions et propositions nous semblait appeler un « devoir de capitalisation » sous la forme d’une synthèse transversale mais aussi d’un enrichissement rendu possible a posteriori par la récente « assemblée nationale des communs » qui s’est déroulée à Marseille du 12 au 14 novembre 2021[2].
Naples ou Bologne : le rapport complexe aux institutions publiques
En tant que telle, la notion de PPC implique une relation à la puissance publique – relation qui ne va pas de soi pour certains commoneurs. C’est sans doute le point qui clive le plus la communauté des communs comme l’illustrent les deux cas emblématiques italiens exposés dans le dossier. Deux modèles se font face en quelque sorte à travers deux expériences : Naples et Bologne.
D’un côté, à Naples, l’occupation d’un bâtiment du centre historique – l’ex-Asilo Filangeri – et sa transformation en commun auto-géré[3] par des militants culturels et des artistes, coalisés avec des militants écologistes, de
