Ukraine, genèse d’une nation
Bien sûr, à l’heure où j’écris ces lignes, je ne sais si la deuxième armée du monde reculera devant la jeune armée ukrainienne. Mais je sais une chose, une nation, ce n’est pas simplement « un plébiscite de tous les jours », comme disait Ernest Renan (1823-1892), « c’est un peuple qui devient le Peuple », comme le dit l’historien Pascal Ory. C’est, comme le disait le grand Lazare Carnot (1753-1829), un peuple, qui réalise l’amalgame entre des citoyens ou des apprentis citoyens, issus de toutes les classes sociales, bourgeoises ou populaires, comme on pouvait le dire des Soldats de l’An II, lorsque ceux-ci clamaient que la patrie était en danger.
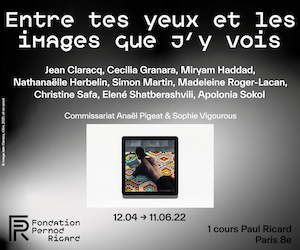
La patrie ? J’entends déjà d’autres clameurs, issues d’internationalistes repentis, qui se demandent si c’est encore le bon mot, pour désigner ce soulèvement admirable du Peuple ukrainien, désormais uni dans un même combat, qui n’exclut pas, comme tous les combats, des dissensions internes, mais qui sont habités, par ceux qui les vivent, comme du temps de la Résistance française, d’une même certitude : parvenir à la neutralisation de l’ennemi. Le mettre en déroute. Et obtenir la victoire.
Comme nombre de mes contemporains, j’ai ressenti l’agression russe, non seulement comme un crime contre l’humanité, mais avant tout, comme une ironie tragique de l’Histoire. Quand on voit aujourd’hui les Juifs d’Odessa quitter leur ville pour s’exiler en Allemagne et en Roumanie, comment ne pas être sidéré devant un tel retournement de l’Histoire.
Il faut pourtant se rendre à cette évidence : l’Histoire n’avoue jamais, comme disait le philosophe Merleau-Ponty (1908-1961), et sa dialectique nous échappe. Cela ne doit pas nous dédouaner de chercher à comprendre les processus qui la meuvent. Il en est au moins deux, dans le cas de l’Ukraine, qui s’imposent : le renforcement de l’identité nationale et le réveil de la société civile. Ces deux enchaînements concomitants devraient nous éclairer.
Du président Volodymyr Zelensky, je connai
