Pour une micro-histoire du présent
Lors d’un congrès international auquel j’ai participé par écrans interposés en temps de pandémie de Covid-19, les organisateurs ont jugé bon d’afficher sur le site-web de l’événement la citation suivante, tirée de la conférence d’ouverture de la deuxième journée donnée par une sociologue : « I’d like to believe that mutual dependance and crisis would result in a positive and joint outcome, such as having a basic income for all. Unfortunately, what the elites are asking is always more for themselves, and not the vulnerable. »
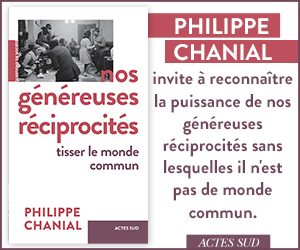
Cette consécration, par les organisateurs, d’une affirmation relevant de l’opinion politique et non de la science, a quelque chose de troublant. Comment peut-on basculer aussi soudainement, dans un congrès scientifique, d’un registre soucieux de l’administration des preuves à un régime politico-moral d’énonciation aussi général, et le revendiquer ? Notre métier, à nous les chercheurs en sciences sociales, consiste pourtant à documenter la réalité sociale, et non pas à juger de ce que cette réalité doit ou ne doit pas être. Notre militantisme politique n’est évidemment pas problématique (qui oserait nous priver de l’exercice de la citoyenneté ?), il le devient lorsque les deux genres, science et politique, se trouvent soudainement confondus.
C’est à l’occasion de telles pertes de repères que nous pourrions nous dire que les intentions gouvernementales récentes, visant à « recadrer » les fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche en sciences sociales, ont quelque chose de légitime. Sauf que pour cela, il faudrait déjà faire la part des choses entre science sociale et philosophie politique (en l’occurrence « décoloniale » et « intersectionnelle »), et voir si les attaques gouvernementales sont à la hauteur des enjeux conceptuels avancés par cette dernière.
D’autre part, nous devrions croire qu’une conversion des enseignants-chercheurs à plus de bureaucratie et à la levée de fonds, et ce dans le cadre d’une concurrence a
