De l’unicité du génocide des juifs
La qualification des atrocités commises par l’armée russe en Ukraine est l’objet d’un vif débat dans lequel le recours au concept de génocide est mobilisé par les uns et refusé par les autres. La dispute n’est pas nouvelle et la référence au génocide nazi contre les juifs virtuellement présente. Il n’est sans doute pas inutile, pour éclairer les présents événements, de revenir aujourd’hui sur la question de son unicité. Le projet est d’analyser le génocide des juifs, non comme un instrument d’occultation, de mise à part, mais comme la matrice de compréhension de la souffrance des autres. Ce projet suppose le refus de l’incommensurabilité comme de l’uniformité.
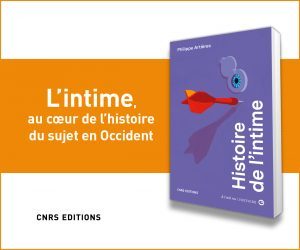
Ni incommensurabilité, ni uniformité
La thèse faisant du génocide des juifs un événement unique, incommensurable à tout autre, une catégorie à lui seul, peut être défendue pour de multiples raisons, mais elle a l’inconvénient de se placer dans l’ordre, non historique, de l’exceptionnel. Bien entendu, du point de vue de l’historien tout événement est unique. S’il s’agissait de débattre de cette question, l’affaire serait rapidement réglée. En réalité, dans la revendication d’unicité de nombreux auteurs, juifs pour la plupart (mais non exclusivement), il y a tout autre chose.
Il faut, pour la comprendre, accorder une place importante au symposium annuel de la revue Judaism, tenu à New York, le 26 mars 1967, et qui réunissait Emil L. Fackenheim, Richard H. Popkin, George Steiner et Élie Wiesel. C’est à partir de ce moment que s’est développée ce que Michael A. Bernstein appelle « une idéologie monothéiste de la catastrophe ». Cette formule a le mérite d’insister sur le contexte théologique dans lequel s’inscrit la thématique de l’unicité. Elle donne, dès lors, plus de consistance à l’idée d’une singularité absolue du génocide des juifs. Il s’agit ici, au contraire, de faire de celui-ci un schéma de compréhension, non seulement d’autres événements passés mais aussi d’événements présents ou récents, ainsi
