La puissance, avenir de la gauche ?
Dans l’état actuel du paysage politique français, il serait présomptueux de croire que la gauche soit en position de force, et ce n’est assurément pas dans ce genre de wishful thinking qu’il s’agit de se complaire ici. On voudrait plutôt s’interroger sur la singulière absence d’un concept politique fondamental chez les partisans de la république démocratique et sociale. Une absence qui n’est sans doute pas sans lien avec leurs propres difficultés à proposer une alternative convaincante à des politiques pourtant largement rejetées.
De fait, on éprouve généralement une réticence, à gauche, à parler de puissance. Celle-ci est liée, tout particulièrement en France, à la raison d’État, au nationalisme, et à l’impérialisme colonial. Plus précisément, l’idée de puissance y est appréhendée essentiellement sur le mode de la nostalgie, sinon de la mauvaise foi. Dans l’histoire récente, le désastre traumatique de juin 1940 a d’autant moins disparu de la mémoire collective qu’il a fait l’objet d’une tentative de refoulement de la part de celui-là même qui a fondé le régime de la Cinquième République, sous lequel nous vivons encore.
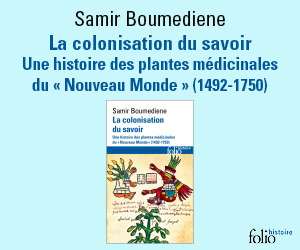
Et pour ne rien simplifier, le même homme, dans le même temps, ne mettait fin à la plus douloureuse des guerres de décolonisation que d’une manière très ambiguë : appelé par ceux qui refusaient de solder l’héritage colonial, il l’a accompli au prix d’un déni toujours persistant de la réalité même de ce conflit, dans un silence qui pèse toujours sur la population française, issue ou non de l’immigration maghrébine.
Certains, non sans de bons arguments, font le pari que le travail que doivent accomplir les partisans de l’émancipation et du progrès social consiste précisément à continuer de s’affranchir de l’imaginaire et du lexique de la puissance[1]. Cette thèse, qui a au moins le mérite d’affronter le problème, souffre néanmoins de deux faiblesses majeures. Sur le plan tactique d’abord, elle revient à laisser la thématique de la puissance à
