Zéro artificialisation nette : banc d’essai de la planification écologique
Depuis son inscription dans la loi Climat et résilience d’août 2021, l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) fait l’objet de débats passionnés dans le monde de l’aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de l’immobilier. Sa finalité ? Amener les territoires de France, à partir de 2050, à des projets de développement qui n’utilisent pas plus de nouvelles terres que ce qu’ils sont capables d’en rendre à la nature ou à l’agriculture.
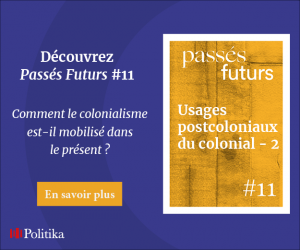
Par ce biais, il s’agit de préserver des espaces pour l’agriculture – notamment si sa conversion vers des modes plus écologiques nécessite davantage de surfaces – mais aussi de préserver la biodiversité. En effet, l’extension des surfaces urbanisées et le morcellement des milieux naturels par les infrastructures sont responsables de la disparition de nombreuses espèces. Mais ce mécanisme du ZAN ne va-t-il pas bloquer la construction, entraîner une hausse des prix des logements et des locaux professionnels ou encore réduire drastiquement les capacités d’action des élus locaux[1] ? D’un autre côté, ne permet-il pas d’enclencher une réorientation de l’urbanisation en faveur d’un plus grand respect des espaces naturels et agricoles et d’une utilisation plus intense des sols déjà urbanisés ?
Ici il s’agit moins de débattre sur le bien-fondé de cette mesure que sur les conditions de mise en œuvre d’un tel objectif. En effet, réduire l’artificialisation des sols jusqu’à un niveau presque nul en 2050 n’appelle pas seulement à réécrire les documents d’urbanisme actuels ou à poursuivre la réflexion sur les nouvelles formes urbaines à venir mais aussi plus largement à repenser l’ensemble du système politique, culturel et financier de l’aménagement des territoires. Le « zéro artificialisation nette » nous permet ainsi d’entrevoir l’ampleur des mutations qu’appelle la planification écologique.
Continuité rhétorique, rupture pratique
Revenons sur l’objectif de « zéro artificialisation nette ». De quoi s’agit-il
