L’éthique de la communication des sciences
La communication scientifique est depuis toujours un sujet aussi politique que la science elle-même, comme le montre le travail des historiens sur les premiers musées de sciences et les grandes expositions du XIXe siècle. Mais la volonté récente d’intensifier et de rendre plus efficaces les actions de communication à destination du grand public dans des domaines de recherche particulièrement sensibles, aussi justifiée soit-elle, dans son principe, comme réponse aux menaces que font peser sur l’espace public les « marchands de doute » et les « négationnistes », pourrait faire vaciller le socle des relations entre sciences et démocratie, et nuire ainsi à la place centrale dévolue au sein de cette dernière aux organisations dédiées à la production et à la transmission du savoir.
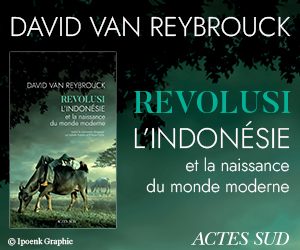
On peut définir la communication scientifique comme l’activité visant à enrichir et orienter la conversation collective sur les sciences et les techniques. Portée par des acteurs aux conceptions et aux intérêts très divers, elle s’exerce désormais au sein d’un espace médiatique devenu remarquablement perméable aux idées réactionnaires et aux théories du complot.
Les questions scientifiques les plus importantes, en matière d’environnement et de santé par exemple, suscitent des discussions biaisées, polarisent les opinions et font croître des micro-communautés épistémiques au sein desquelles se diffusent rumeurs et fausses nouvelles. Ce phénomène, désormais bien documenté, est loin d’avoir reçu une explication générale satisfaisante. Au regard des enjeux pour des démocraties engagées à relever les défis immenses de l’anthropocène, la fragilité et l’ambivalence de la communication des sciences en font un sujet d’intérêt public et de préoccupation majeur.
Le problème n’est pas celui d’un effondrement général de la confiance dans les sciences ou de l’avènement d’un régime de « post-vérité ». D’après de récentes enquêtes, la confiance dans la science comme institution s’érode beaucoup moins
