Guerre et genre :
la confiscation des corps masculins
La variable genre constitue un outil particulièrement pertinent pour comprendre les phénomènes sociaux. Formulé quasi exclusivement comme synonyme de « femmes », en théorie le genre englobe également les hommes.
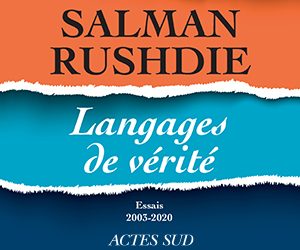
Comme le souligne Delphine Naudier, « en sciences humaines et sociales, le genre est un concept pour analyser tout ce qui se réfère aux êtres humains, à leurs relations, à leurs rapports sociaux, et aux valeurs symboliques classées traditionnellement en deux catégories : le féminin et le masculin. Le genre est, en cela, un outil scientifique pour se départir de ce que Durkheim qualifiait de prénotions, à savoir l’ensemble de nos croyances, de nos préjugés, de nos passions, de nos impressions vagues, confuses, sur les gens, les choses, le monde et ses affaires[1]. »
Concernant la guerre, l’assignation à des rôles genrés est particulièrement frappante : les hommes sont « programmés » idéologiquement pour mourir sur le champ de bataille, pour devenir de la chair à canon[2]. Il s’agit d’un élément qui structure non seulement le stéréotype masculin mais la société toute entière, au point qu’elle délègue « naturellement » la violente tâche de donner sa vie pour autrui aux hommes. De même, l’Église ira jusqu’à reconnaitre que donner la mort en combattant faisait partie des devoirs du guerrier et ne constituait pas un péché.
Ainsi, par adhésion, par sens du devoir, par patriotisme, par obéissance, par peur ou par résignation, des millions de jeunes ont endossé l’uniforme de soldat et sont partis au front en renonçant à tout : foyer, famille, travail, amis… Il suffit de regarder les prénoms gravés sur les monuments aux morts de nos villages : Jean, Pierre, François, Louis, Arsène, Joseph, Raymond… Personne ne s’étonne de l’absence de prénoms féminins. Même les vivants ont intégré l’exclusivité masculine dans la mobilité forcée, l’errance et la mort, tellement que, lorsqu’il s’agit de la guerre, nous possédons une conviction limitée quant à la nécessité du c
