Goffman, toujours tranchant
Le sociologue nord-américain Joseph Gusfield, qui a fait ses études à l’Université de Chicago à la fin des années quarante, racontait volontiers que ses camarades et lui avaient donné à Erving Goffman le surnom de « petit poignard » (little dagger). Ils faisaient allusion aux réparties acérées de leur condisciple, dont il fallait se méfier un peu[1]. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que Goffman allait vivre toute sa vie en petit poignard, toujours à la recherche de l’arête tranchante (cutting edge).
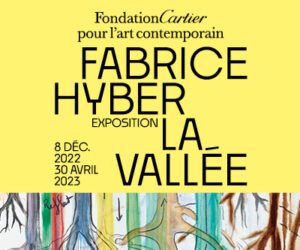
Encore moins qu’il allait un jour prescrire à ses jeunes collègues, qui l’écoutaient (et l’enregistraient en secret) lors d’une session de l’Association des sociologues de la côte ouest, de « s’entailler jusqu’à l’os » (you must cut yourself to the bone) s’ils voulaient réussir leur immersion dans le terrain[2].
Goffman, peut-on avancer, a intégré la coupure tranchante autant dans son rapport au monde social (« Cut the crap », me dit-il un jour de septembre 1978 alors que je me comportais en étudiant poli avec lui) que dans son rapport au monde de la recherche. Parcours de la vie et de l’œuvre de Goffman dans cette perspective.
La très récente publication de sa thèse de doctorat par une courageuse petite maison d’édition américaine dirigée par l’universitaire Jefferson Pooley[3] permet de découvrir un étudiant d’une ambition assez folle, qui ose braver les attentes de son jury pour proposer une théorie générale des interactions sociales. De son séjour d’un an (en mois cumulés entre décembre 1949 et mai 1951) sur l’ile de Unst, tout au bout des Shetland, il ne rapporte pas une ethnographie mais des données dont il va se servir pour construire une trame théorique – qui sera celle de toute son œuvre, jusqu’à son texte testamentaire, « L’ordre de l’interaction », dont le titre est celui du dernier chapitre de sa thèse.
Sans chercher à tout prix des métaphores coupantes dans ce document fondateur, on peut néanmoins faire remarquer que son écriture très directe, tr
