Travailler au quotidien avec Bruno Latour 2/2
Développer un domaine de recherche en dehors des disciplines instituées n’est pas une mince affaire. Il faut être capable de se donner des collègues, de constituer en somme ce qu’on appelle une communauté scientifique. D’abord pour organiser des échanges et un travail collectif, ensuite pour devenir visible, attirer des étudiants, avoir accès à des ressources, à des revues et à des éditeurs.
Se donner des collègues
Bruno disposait des deux atouts stratégiques pour y parvenir. D’abord une claire vision des enjeux théoriques qui lui permettait de viser haut et de souligner explicitement les faiblesses et les limites inhérentes à la sociologie, toutes tendances confondues. Ensuite un véritable esprit entrepreneurial. Pour lui, exister c’était convaincre, non pas en accumulant du capital comme les esprits vulgaires et cyniques aiment à le faire, mais en promouvant ses productions et en discutant leurs qualités : pour lui le client était roi.
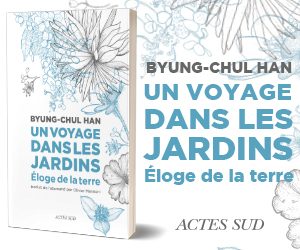
Lors de son séjour aux US, il avait participé activement à la création de la 4S qui très rapidement avait rassemblé tous les chercheurs, américains et anglais, qui partageaient le même programme. Une fois rentré en France et installé au CNAM, il avait organisé presque sans moyens des workshops notamment avec les collègues britanniques. Très rapidement il eut l’idée d’un bulletin, qu’on décida d’appeler Pandore pour des raisons aisément compréhensibles, et qui devait servir de newsletter. Le plus difficile fut de constituer un fichier pertinent. On le construisit de bric et de broc à partir de sources hétéroclites. Peu à peu, à coup de purges et d’adhésions, il devint un bon outil de communication et de circulation de l’information. Bruno était un lecteur infatigable (un de ses collègues américains m’avait dit avec ce ton qu’on a quand on est face à un comportement anormal: « il lit même dans les parkings ») qui désirait partager ses lectures et ses enthousiasmes.
Au fil des mois Pandore multiplia les comptes rendus de livr
