Hors sujet : théorie de ma situation climatique
Dans la première conférence de son livre Face à Gaïa, le très regretté Bruno Latour passe en revue une série de « rapports » des sujets aux mutations écologiques du monde, dont le changement climatique est le paradigme. Il est intéressant de revenir à ses réflexions à l’heure où des militants écologistes prônent un mode d’action radicale, que l’ADEME publie son 23e rapport sur les représentations sociales du changement climatique, et que la COP 27 a suscité les commentaires de défiance bien connus.
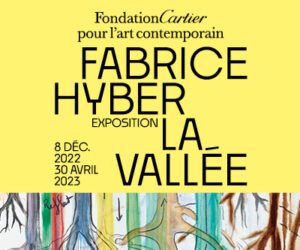
Les climato-sceptiques n’ont pas complètement disparu : ils entretiennent encore l’idée que les chiffres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ne sont pas fiables. Un autre rapport à la crise écologique, beaucoup plus répandu, prend la forme du quiétisme. On ne se précipite pas dans le catastrophisme, on n’enquiquine pas les autres avec toutes les urgences auxquelles ils devraient réagir. Et puis il y a ceux qui ont été sensibles aux alertes et qui prétendent sortir des problèmes par un surcroît d’ubris technologique, géo-ingénierie et autres moyens de contrôler l’écosystème terrestre dans sa totalité. La conscience de la crise écologique en déprime d’autres, qui savent ce qui se passe mais savent aussi à quel point ils sont démunis. Les militants ou les porteurs de bonne parole institutionnelle continuent à y croire. Ils font la promotion de la panoplie des solutions. Quelques-uns, plus rares, se sont retirés dans l’isolement de leur activité et, sans prétendre résoudre la crise écologique, surmontent les angoisses qu’elle suscite en eux. Aujourd’hui surgissent les radicaux lanceurs d’alertes, qui espèrent faire bouger les foules et surtout les médias en lançant de la sauce tomate sur des œuvres d’art.
Cette liste de postures pourrait fonctionner comme une injonction adressée au lecteur. Vous, oui, vous, où vous situez-vous ? Dans quel rapport concret, pratique, intellectuel, moral êtes-vous avec le monde que des mutations éco
