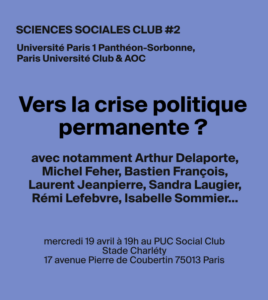Gauche : d’abord la farce, puis la tragédie ?
Des mouvements sociaux importants s’opposent à la réforme des retraites. La méthode antidémocratique du gouvernement, qui a adopté la loi grâce à un artifice constitutionnel (l’article 49.3), est quasi-unanimement critiquée.
La popularité du président Macron est au plus bas et la majorité relative du groupe parlementaire Renaissance est aujourd’hui synonyme de paralysie législative. Une contestation sociale virulente traverse l’ensemble des classes socio-professionnelles, et un front syndical uni mène la lutte sur le terrain de la grève et de la manifestation.
Et la gauche partisane ? Ne devrait-elle pas surfer sur la vague du mécontentement social ? Ne devrait-elle pas rassembler les classes populaires et moyennes, affectées par la réforme ? N’est-ce pas, pour la gauche, une situation exceptionnellement idéale ? Il n’en est rien. La gauche demeure aussi faible qu’avant l’élection présidentielle de 2022 ; une faiblesse historique, puisqu’elle ne rassemble qu’entre 24 et 26 % des intentions de votes tous partis de gauche confondus. À titre de comparaison, une gauche « faible » était créditée d’au moins 40 % des voix entre les années 1990 et 2010.
Il est surprenant que la crise profonde de la gauche – car c’est bien cela dont il s’agit – suscite aussi peu d’analyses qui tentent d’identifier les causes majeures de ce déclin. Dans le meilleur des cas, des observateurs et acteurs politiques s’interrogent sur la nature de la Nupes: est-elle une confédération politique ou une simple alliance électorale ? Faudrait-il passer à un acte II de la Nupes ? Dans le pire des cas, c’est le silence, voire le déni quant à la gravité de la situation. (« Il ne faut pas croire les sondages » ; « répéter que la crise politique va bénéficier à Le Pen, c’est une prophétie autoréalisatrice » ; « Mélenchon va gagner en 2027 »).
La perte d’audience de la gauche partisane est multifactorielle et ne sera pas simple à résoudre. Mais il est possible de relever quelques anomalies qui permettent de