Les communes face aux énergies renouvelables
Depuis les dernières élections municipales de 2020, plus de 900 maires ont démissionné de leurs fonctions. Ce sont essentiellement des maires de petites communes rurales. Ce chiffre est en augmentation par rapport au mandat précédent. Il ne s’agit certainement pas du seul indicateur qui peut servir à révéler les difficultés auxquelles font face les élus municipaux.
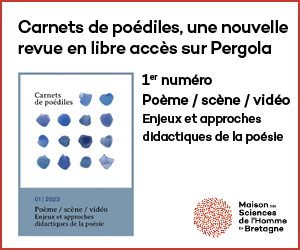
Budgets contraints, surcharge de travail, accumulation d’exigences réglementaires mais en même temps restriction des champs de compétences, manque de moyens humains, attentes abusives des électeurs, isolement, agressions indignes comme l’actualité l’a encore montré récemment.
Et pourtant les communes, dans leur configuration et leurs limites actuelles, semblent devoir rester l’échelon minimal de la vie politique française : à la fois premier échelon de la représentation politique, pour ne pas dire de la souveraineté populaire dont la présidence de la République se veut être, à l’opposé, l’expression centrale, et premier niveau de l’administration des affaires publiques. Les communes demeurent « le sol » que toutes les politiques publiques doivent présupposer pour empiler leurs interventions et l’exercice des compétences administratives propres à chaque échelon (coopération intercommunale, syndicats, département, région et État).
La récente loi relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables (10 mars 2023) illustre de nouveau la tendance persistante à investir la commune d’une fonction politique première. Mais elle dévoile simultanément, de manière exemplaire, les incohérences et les amnésies qui font le prix du casting communal dans la mise en œuvre d’une politique de transition énergétique déterminante pour l’avenir.
Dans son article 15, la loi du 10 mars 2023 indique que les communes auront à définir des zones visant à accélérer l’implantation d’unités de production d’énergie, quelle que soit la filière (éolien, photovoltaïque, méthanisation, géothermie). L’enjeu est simp
