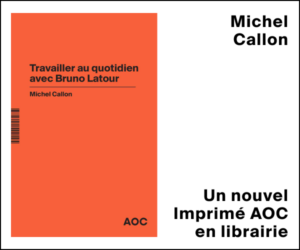Peut-on encore « aller mal » sans pour autant « être malade » ?
On ne compte plus les constats alarmants sur la misère de la psychiatrie française[1] auxquels depuis quelque temps viennent s’ajouter les alertes sur la santé mentale des Français.
La dénonciation de la paupérisation de la psychiatrie ne peut pourtant se poser qu’en termes de moyens, elle doit s’accompagner d’une réflexion sur la manière dont nous soignons la souffrance psychique, qui est elle-même dépendante du statut que nous accordons au psychisme et à la vie psychique. Il ne s’agit pas d’un problème qui concernerait les seuls praticiens ou les épistémologues de la psychiatrie mais la société toute entière, école comprise.
Or force est de constater que nous n’avons pas, ou trop peu, cette discussion. C’est bien un certain paradigme, que l’on pourrait appeler par commodité le paradigme « biomédical » qui est devenu hégémonique. Au sein de ce paradigme, toute souffrance psychique doit recevoir une caractérisation nosographique – il faut l’inscrire dans une classification pathologique désormais extensive[2]. Il faut donc d’emblée l’associer à un comportement immédiatement repéré comme « anormal ». Mais cette anormalité est entendue en un sens tout à fait spécifique : elle renvoie à une inadaptation aux normes et aux injonctions sociales, et jamais ou trop peu, à ce que le sujet peut ou ne peut plus supporter pour lui-même, « ce sentiment de vie contrariée » dont parlait Canguilhem lorsqu’il définissait la maladie comme sentiment d’une puissance vitale amputée.
Tout diagnostic inscrit donc a priori le sujet dans le spectre d’un trouble pathologique, c’est là le nerf du « diagnostic », passage obligé de la « prise en charge » du patient : du trouble psychique à la maladie mentale, il y a désormais continuum. Nous sommes entrés dans l’ère où la qualité d’une vie psychique heurtée ne semble pouvoir être appréhendée qu’à l’aune de catégories pathologiques, dans une langue protocolisée, désincarnée, abstraite de tout ce qui pourrait la rendre singulièrement signifiante. Ce n’est plus une différence qualitative qui sépare ce qui est désormais nommé minimalement « trouble » de la « maladie ».
Classification, uniformisation, codification, des termes qui ne signifient plus rien, parce qu’ils ne renvoient à autre chose qu’à eux-mêmes, hors de tout texte, et de toute histoire singulière. Du « TDAH » au « burn-out » autant de mots devenus écrans de réalités à chaque fois irréductibles, qu’on soigne principalement à coup de psychotropes voire de rééducations cognitivo-comportementales protocolisées qui ont trop souvent l’allure sinon le contenu d’un dressage.
Ce type de pratique est d’autant plus préoccupant lorsqu’elle concerne les jeunes enfants et les adolescents auxquels bien souvent on propose en première intention des thérapeutiques d’emblée médicamenteuses. Les impasses auxquelles conduisent cette médicalisation des symptômes psychiques sont pourtant documentées et les autorités de santé elles-mêmes semblent s’inquiéter de la généralisation du recours aux psychotropes. N’avons-nous pas autre chose, de la psychothérapie à l’éducation, à proposer à nos enfants et nos adolescents qui vont mal ?
Tout se passe pourtant comme si rien de cela ne parvenait à être entendu, peut-être d’abord précisément parce que nous avons affaire à une idéologie qui a réussi le coup de force de nous faire penser dans ses propres catégories passées dans la langue ordinaire[3]. Or nous pensons toujours à travers des mots et des catégories langagières : l’attente sociale concernant le soin psychique se formule désormais dans la langue biomédicale. Les citoyens se rapportent aujourd’hui à leurs souffrances et à leurs peines d’emblée à travers les étiquettes du trouble. Quand ils ne l’ont pas eux-mêmes plaqué sur leurs symptômes, ils demandent un diagnostic pour être reconnus comme tels. Canguilhem décrivait le refus et la résistance que pouvait déployer un sujet quand on cherchait à l’assimiler à sa maladie[4] . Les choses semblent s’être littéralement inversées pour laisser place au désir de voir sa souffrance constituée en trouble identifiable et identifié, et soi-même assigné à la place du malade[5].
Le dialogue n’est plus au cœur du dispositif de soin psychique.
Or en les naturalisant et en les médicalisant intégralement, en en faisant des réalités objectives sur lesquelles seule la science, la dure, la vraie, pourrait quelque chose, nous nous nous privons de notre capacité à nous les approprier : nous perdons notre responsabilité, et avec elle un pouvoir infini et imprévisible de les renégocier pour nous en libérer autant que possible. Cette appropriation ne peut passer que par l’arme la plus puissante dont nous disposions : le langage, un langage qui ne peut être réduit à la langue opératoire des classifications médicales, une langue sans affect et sans histoire. Car dans cette langue on ne se parle plus. Au nom de la science, une pratique institutionnelle disqualifie ce qui fait pourtant de nous les vivants singuliers que nous sommes : la manière que nous avons de nous rapporter au monde et à ce que nous en vivons dans et par des actes de parole qui constituent autant de manières de se positionner comme les sujets de nos vies. Le psychique est le creuset de cette liberté qui définit la subjectivité et il dispose en cela d’un statut irréductible.
Le soin psychique ne peut dès lors faire l’économie d’une attention portée à l’épaisseur de nos vies psychiques, à la trame que nouent et dénouent les fils psychopathologiques dans une histoire individuelle et sans lequel la thérapie pourrait tout à fait être administrée, certains en rêvent déjà, par une Intelligence artificielle.
Nous avons évidemment besoin des formidables avancées des neurosciences qui nous en apprennent tant sur la composante biologique des phénomènes psychiques, ce qui est d’autant plus fondamental pour soigner les maladies psychiatriques, mais nous avons aussi besoin de cultiver ce sans quoi une vie psychique n’en est pas une, son histoire et la manière dont nous y rapportons par la parole, un acte toujours irréductiblement singulier et, parce qu’il est toujours adressé, qui demande à être entendu. Or le dialogue (si l’on entend par là autre chose qu’une communication standardisée sur des symptômes et des protocoles référencés) n’est plus au cœur du dispositif de soin psychique. Là où le grec pathos dit d’ailleurs originellement beaucoup plus que ce que nous entendons aujourd’hui par « pathologique » – le pathos, c’est ce qui affecte, ce que l’on éprouve –, il n’est plus possible d’ « aller mal » sans être considéré comme « malade ».
C’est d’autant plus préoccupant pour les enfants et les adolescents, à un âge où le plus souvent rien n’est encore joué une fois pour toutes, l’expérience clinique l’a tant de fois montré. Nous savons combien une rencontre, une parole, en apparence anodine, celle d’un enseignant, celle d’un éducateur, celle d’un médecin, celle d’un psy peut ouvrir un champ aussi inattendu qu’inespéré, celui de ce qu’on appelle, en une acception bien différente de ce qu’en a fait le néolibéralisme, l’autonomie. Or comme le rappelait Castoriadis, les ressorts de l’autonomie politique sont d’abord psychiques. Il n’est donc peut-être pas anodin que la crise démocratique que nous vivons se donne d’abord, et là aussi, comme une crise de la parole et de ce qu’elle peut. Il y a là le fondement du lien social : sans dialogue, il n’y a pas de politique, parce qu’il n’y a pas de commun. C’est de cela aussi dont nous devrions nous rappeler lorsque nous pensons le soin psychique : c’est d’abord là que tout se joue.