« Débarkhaniser » ! Quand les militaires montrent le chemin à l’aide internationale
Un récent article de Monde Afrique[1] témoigne du changement radical des modalités d’intervention de l’armée française en Afrique dans la lutte contre le jihadisme.
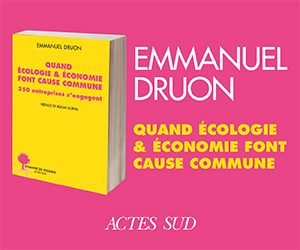
La défunte opération Barkhane fonctionnait en enclave, comme le veut la culture militaire des opex (opérations extérieures) en vigueur depuis des décennies, et elle menait donc en territoire malien sa propre guerre contre l’insurrection, sans réelle coordination avec les Forces armées maliennes (FAMA), il est vrai démotivées et en triste état, sans faire de la protection rapprochée des populations une quelconque priorité (ce qui est pourtant la clé de toute guerre asymétrique), sans compréhension de la complexité des sociétés locales (quelques clichés ethniques en tenant lieu), et en suivant une stratégie définie par ses seuls chefs (en l’occurrence ciblée sur l’élimination des dirigeants jihadistes). Cette « politique militaire hors sol » a non seulement échoué (l’insurrection a progressé au Mali malgré la présence de Barkhane), mais elle a aussi été une des causes majeures de l’impopularité de la France et du départ peu glorieux des soldats français exigé par l’actuel régime militaire de transition[2].
Toutefois les responsables de la politique militaire française ont manifestement tiré les leçons de cet échec, et les forces françaises suivent désormais au Niger un chemin qui diffère à 180 degrés de celui qui était le leur au Mali. Le Monde Afrique, se basant sur l’AFP, rapporte ce propos du général Bruno Baratz, commandant des Forces françaises au Sahel (FFS) : « Au Niger et même de façon globale partout en Afrique, la position philosophique est différente de ce qui se faisait au Mali. Aujourd’hui, notre aide part d’abord du besoin du partenaire ». Une autre citation le confirme, du côté nigérien, celle de Kalla Moutari, ancien ministre de la Défense : « Aujourd’hui le commandement est nigérien, maître du terrain et des besoins ». Bien évidemment les autorités nigériennes ont joué en l’affai
