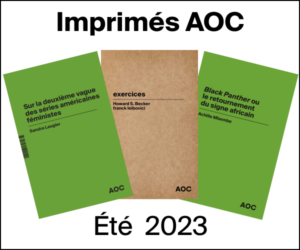Israël : fin de règne, fin du rêve ?
Comment comprendre le massif et durable mouvement de protestation contre les réformes que le gouvernement Netanyahou s’efforce de mettre en œuvre, depuis le retour au pouvoir du chef du Likoud aux élections du 1er novembre 2022, qui ont donné naissance au gouvernement le plus à droite de l’histoire du pays ?
Le 26 août, on en était au 34e samedi consécutif de manifestations qui ont parfois rassemblé jusqu’à 100 000 personnes rue Kaplan, « capitale » de la révolte, au centre de Tel Aviv, et le même nombre dans le reste du pays, sur les grand-places, aux carrefours. Du jamais vu, même en Israël où l’on manifeste beaucoup et pour les raisons les plus variées. Il faudrait citer aussi les tentatives pour bloquer le principal aéroport du pays, les manifestations devant la Knesset, l’une précédée par une longue marche vers Jérusalem, les sit-in devant les domiciles des ministres de la coalition que l’on brocarde copieusement…
Autre nouveauté : les régimes occidentaux traditionnellement alliés d’Israël, à part des critiques récurrentes mais limitées de l’occupation, ont pris parti contre le gouvernement. Même les États-Unis, l’allié traditionnel dont la sécurité d’Israël dépend étroitement, ont élevé la voix, jusqu’au président Biden, l’un des plus pro-israéliens de son parti : après avoir appelé comme tant d’autres à un compromis entre gouvernement et opposition, il a fini par demander à Netanyahou de mettre un terme à la réforme judiciaire. D’anciens ambassadeurs américains en Israël, des éditorialistes prestigieux, questionnent l’avenir de l’aide militaire à l’État hébreu. Et l’opinion publique suit, au moins les jeunes électeurs et les électeurs démocrates, qui pour la première fois soutiennent plus les Palestiniens que les Israéliens. Le Congrès, toutefois, reste solidement pro-israélien, à part la minorité de la gauche démocrate.
Ce soutien pour l’opposition va paradoxalement de pair avec une forme d’éloge du pays : les médias occidentaux, y compris les médias de gau