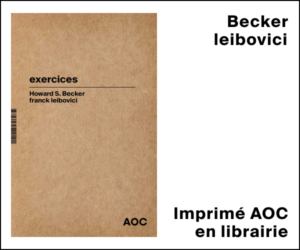Pornographie : l’enfer de l’idéologie prohibitionniste
Après six mois de travaux et des dizaines d’heures d’auditions – dont celle, à huis clos, de victimes de l’affaire dite « French Bukkake[1] », le 28 septembre 2022, la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes du Sénat présentait un rapport sur l’industrie de la pornographie intitulé « Porno : l’enfer du décor ».
Certaines de ses propositions ont été intégrées dans un projet de loi (n° 593) actuellement en débat à l’Assemblée nationale et d’autres textes s’y sont inspirés (décret, Arcom, proposition de loi…).
Pornographie, l’abolition comme remède ?
À la lecture dudit rapport, le juriste soucieux des droits fondamentaux et des libertés publiques ne peut être qu’inquiet. Déjà, par la définition extravagante de la pornographie proposée par le rapport : « La pornographie consiste dans l’exploitation commerciale de la représentation explicite et filmée de pratiques sexuelles non simulées » (p.34). Et ensuite, par sa première recommandation : « faire de la lutte contre les violences pornographiques et la marchandisation des corps une priorité de politique publique » et plus particulièrement, « une priorité de politique pénale » (p.105).
Si la lutte contre la pédopornographie et la limitation effective d’images pornographiques aux mineurs sont évidemment nécessaires[2], l’interdiction d’acteurs, de consommateurs, de producteurs et de diffuseurs de pornographie constitue non seulement une ingérence illégitime de l’État mais également une violation à la vie privée, à la liberté d’expression, à la liberté de commerce et à celle d’industrie.
Le rapport fait constamment référence à la « violence pornographique » sans la définir vraiment et, pire encore, par une ambigüité méthodologique constante, laisse entendre que l’activité pornographique relèverait des violences volontaires réprimées par la loi pénale. La présidente du Mouvement du Nid conforte ce point de vue dans son audition en déclarant : « L’industrie du porno est une