Au Brésil, le retour du « droit de conquête » ?
Depuis quelques semaines, le Suprême Tribunal Fédéral du Brésil (STF) est appelé à statuer sur la constitutionnalité d’une loi, votée par le parlement brésilien, et appelée « marque temporelle ».
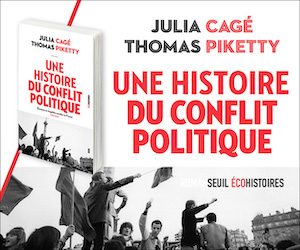
Il s’agit d’une proposition juridique selon laquelle les communautés autochtones n’auraient le droit de revendiquer, dans le cadre de la démarcation de leurs terres, dont le processus est prévu par la Constitution de 1988, que celles qu’ils occupaient en 1988, soit près de cinq siècles après la conquête portugaise.
Cette loi, en projet depuis 2007, suscite au Brésil un large débat de société, dont les arguments des ministres du STF sont pour partie le reflet. Or, lors des récents débats du STF, l’un des juges (André Mendonça, nommé par l’ex-président d’extrême-droite, Jair Bolsonaro) a justifié son vote en faveur de la marque temporelle par le droit de conquête : « Les terres brésiliennes ont été transférées des peuples originaires à la couronne portugaise par le droit de conquête ». L’usage d’un tel argument juridique, en 2023, invite l’historien à une mise au point, car il soulève deux questions fondamentales, qui illustrent les usages utilitaristes du passé par l’extrême-droite contemporaine.
La première question consiste à savoir qui est dépositaire de ce droit. En l’occurrence, il s’agit très clairement ici de l’église chrétienne qui, aux débuts de la conquête des Amériques, prétendait décider du sort du monde. C’est en effet sous l’égide du pape Alexandre VI que les couronnes d’Espagne et du Portugal ont signé en 1494 le Traité de Tordesillas, partageant le monde à découvrir et conquérir en deux – celui des Espagnols et celui des Portugais. Quelques années plus tard, très ironiquement, François Ier demandera à voir la clause du Testament d’Adam excluant la France de ce partage.
C’est la bulle papale Inter Caetera, signée en 1494, qui a fondé la doctrine de la conquête chrétienne en affirmant que lorsqu’une nation chrétienne trouve une terre qui n’a pas encor
