Ce que l’autisme fait aux « techniques de soi » : pour un autre sens du bizarre
De nombreuses voix appellent à considérer l’autisme comme une condition plutôt que comme un trouble, et les personnes concernées comme une minorité. Mais de quelle minorité s’agit-il[1] ?
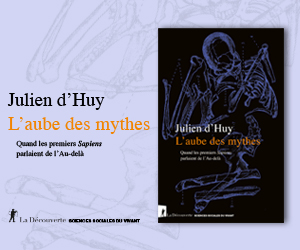
Comment l’autisme peut-il prendre place dans les mouvements des minorités ? Qu’a-t-il à leur apprendre, à révéler de l’expérience minoritaire elle-même ? Personnellement concerné, je voudrais défendre ici l’idée que l’essentiel relève de l’expérience du corps dans son lien à la socialisation : indisponible aux « techniques de soi », le corps « autiste » propose en effet une « autre bizarrerie » que celle qu’a théorisé le mouvement queer ; plasticité singulière du corps déformant les habitus, il engendre une expérience minoritaire intrinsèque[2].
L’autisme, du déficit à la condition
Je commencerai par rappeler qu’il n’existe à proprement parler pas de définition scientifique consensuelle de l’autisme mais des critères diagnostics. L’autisme est aujourd’hui diagnostiqué lorsqu’une personne présente les conditions suivantes : des particularités de la communication sociale et de l’interaction sociale et des comportements, intérêts et activités répétitifs, inhabituels, sur lesquels la personne se focalise[3]. Mais les symptômes qu’ils permettent d’identifier et leur sévérité sont aussi nombreux et divers, et connaissent un taux de recoupement important avec d’autres conditions. Cette diversité ne permet actuellement d’établir aucune sous-catégorie cohérente[4] ; on parle donc des troubles du spectre de l’autisme. (La classification est faite en fonction de l’existence et de l’intensité des situations de handicap dans lesquelles se trouvent les personnes autistes.
Les spécialistes accoutumés à interagir avec des personnes autistes mettent cependant d’autres aspects en exergue, en particulier la posture et l‘intonation ; ceux-ci ne relèvent pas directement de la grille diagnostique, et renvoient à une dimension physiologique, qui semble dépasser largement le champ des troubles e
