Pour mieux protéger la liberté artistique
Une exposition de photographies consacrées à la vie des Roms expulsés de leur logement devait se dérouler dans la médiathèque d’une ville de l’estuaire de la Gironde. Elle a été interdite par le maire (sans étiquette) avec l’argument que les habitants de sa ville « ne vont pas s’intéresser » à une exposition consacrée à des événements qui se déroulés dans une lointaine ville de la région parisienne ![1]
C’est à peine si l’on s’étonne d’un tel interdit municipal, tant les attaques, censures et autres restrictions à la liberté artistique se sont banalisées au point de faire partie de notre actualité quotidienne. Elles sont s’y récurrentes qu’elles ont même un musée à Barcelone où nombre d’œuvres censurées sont présentées pour nous rappeler la question non résolue : face à l’ampleur des réactions hostiles, comment nos démocraties peuvent-elles un peu mieux protéger la liberté artistique ?
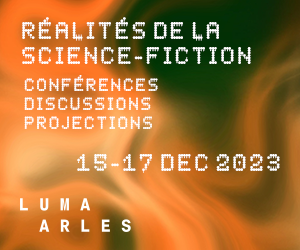
La réponse de la République française a été, principalement, de renforcer son appareil législatif. Toutefois, à l’épreuve du quotidien, les failles sont trop béantes pour s’en satisfaire. Face aux tourments du monde, une autre voie est nécessaire pour que la liberté d’expression artistique ne reste pas une abstraction sans densité démocratique et à faible portée pratique.
Protéger par la loi, la judiciarisation et la création artistique
Remontons à l’année 2016. La loi Liberté de la création, architecture, patrimoine (LCAP) avait pour objectif de garantir la protection des artistes contre les attaques d’ennemis de plus en plus nombreux à la recherche d’œuvres à détruire. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, s’est fait l’écho de ces dégradations massives : « Des œuvres saccagées, vandalisées, barbouillées de messages antisémites ou repeintes ; des spectacles annulés, des films pourchassés par la vindicte de quelques-uns, ou des artistes décrits comme des fainéants que l’on voudrait employer à garder des enfants. C’est ce climat qu’ont aujourd’hui à subir les artistes et
