La « juste place » des œuvres africaines
Le Metropolitan Museum of Art de New York, le Met pour les intimes, propose depuis bientôt deux ans et pour quelques mois encore une exposition modeste en taille mais très instructive. Instructive parce qu’elle illustre à elle seule plusieurs façons de concevoir la « juste place » qu’il convient de donner aux objets provenant d’Afrique dans (ou hors) des musées occidentaux.
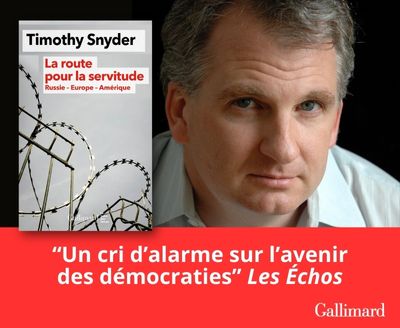
L’exposition se situe dans la section baptisée «Arts d’Égypte», dans l’angle nord-est du bâtiment. Le visiteur est accueilli par deux statues en pied de la déesse Sekhmet gardant l’entrée d’une salle sombre avec en guise de fronton le titre de l’exposition : «The African Origin of Civilization». Il est alors entraîné dans un flux d’installations couplant chacune une œuvre de l’Égypte antique et une autre d’Afrique centrale ou occidentale[1] : par exemple, une faïence bleue de l’époque ptolémaïque représentant la déesse Isis allaitant son fils Horus côtoie une statue de bois d’une femme et d’un nourrisson accroché à son sein gauche, fabriquée en pays Senoufo à la charnière des XIXe et XXe siècles ; à une statue en marbre d’un couple enlacé depuis 4600 ans, venue sans doute de la région de Memphis, répond une autre, aux gestes tout aussi affectueux, faite de bois et de métal, sculptée par des Dogons à la fin du XVIIIe siècle ; une gravure sur gneiss représentant le roi Sahure flanqué d’un dieu, remontant à la 5e dynastie des pharaons, jouxte une plaque en laiton représentant des guerriers edo de la cour du Bénin, probablement coulée à la fin du XVIe siècle. L’appariement de pièces égyptiennes et sub-sahariennes se répète ainsi 21 fois[2].
Pour qui le message ne serait pas assez clair, les commissaires de l’exposition – Alisa LaGamma, conservatrice en charge du « département des arts d’Afrique, Océanie et des Amériques », et Diana Craig Patch, conservatrice en charge du « Département d’art égyptien » – ont pris la peine de rédiger leurs intentions : « À l’aide de 21 couplages d’œuvres afri
