La critique comme attitude
En France, la philosophie est enseignée au lycée, car elle est censée, selon le programme officiel de terminale, « former le jugement critique des élèves ». Mais comment enseigner l’esprit critique ? On pourrait d’abord penser qu’il s’agit de transmettre un ensemble de notions, de doctrines et de principes théoriques hérités des grand.e.s penseur.euse.s du passé, dont la fréquentation et l’usage augmenteraient les capacités de recul critique vis-à-vis de toutes les croyances, les valeurs, les pratiques et les institutions qui ne cessent chaque jour de se présenter à notre attention et d’exiger notre adhésion.
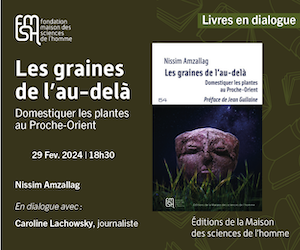
Un certain nombre de ces philosophes s’est d’ailleurs explicitement proposé d’élaborer des théories critiques dont les principes et les catégories de base seraient suffisamment généraux pour pouvoir être appliqués à l’ensemble des discours théoriques ou des situations historiques. Mais une catégorie, un principe théorique, un système doctrinal, aussi critiques soient-ils dans leur intention, ne peuvent empêcher par eux-mêmes qu’on en fasse un usage dogmatique.
La qualification de « critique » elle-même n’empêche pas une théorie philosophique d’avoir des effets dogmatiques. Qu’on songe à ces deux courants majeurs au siècle dernier de la critique philosophique : l’empirisme logique pour la critique des pseudosciences et le marxisme pour la critique des injustices sociales. Sous leurs formes orthodoxes, ils ont chacun contribué à bloquer la voie de l’esprit critique, le premier en frappant de non-sens tout discours raisonné sur les valeurs, le second en invisibilisant les formes d’inégalité non réductibles à celles entre classes socio-économiques.
Une seconde solution semble alors de privilégier certaines méthodes et techniques pour former le jugement critique, plutôt que d’inculquer tel ou tel contenu doctrinal. C’est d’ailleurs à cet objectif méthodologique qu’est censé servir l’entraînement aux exercices philosophiques de la classe de terminale, disse
