Habiter le monde, habiter la création artistique : un pari pour le XXIe siècle
Notre souci de l’habitabilité doit frayer son chemin entre les assignations culturelles exiguës donc désastreuses, et les industries culturelles planétaires donc normatives. « Je peux tout faire » proclame la techno-créativité, « je ne ferai pas tout » dit l’œuvre d’art qui a choisi ce qu’elle ne sera pas.
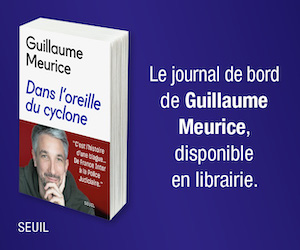
Le pari de l’habitabilité d’un monde réel et d’un monde artistique considère ici trois moments historiques : l’éternité de Pascal, l’éternel retour de Nietzsche, « l’éternel départ » des transhumanistes qui rêvent d’immortalité, quitte à avoir définitivement réglé son compte à toute la planète.
Il y a moins de 400 ans, sous l’intitulé radical « infini-rien », Blaise Pascal formulait son pari de l’existence de Dieu, pour gagner l’éternité. Pesant les risques de gains et de pertes, il utilise un argument mathématique et philosophique : miser une vie finie en vue d’un bonheur infini mais incertain. En 2024, que pourrait être le pari du présent et du devenir préservés, où l’essentiel n’est pas de participer mais bien de l’emporter ?
À chaque époque il y eut un monde en décomposition et un monde en devenir, selon les termes toujours choisis de Nietzsche. Pour ce qui est de la décomposition, les récits déclinistes pullulent. Il est plus ardu de détecter les signes d’un monde en devenir, donc d’entendre l’esprit du temps. Soutenir l’habitabilité du monde et de la création artistique, c’est présupposer l’hypothèse par ailleurs très fragile d’un humanisme du numérique, capable d’intégrer, d’infléchir le pouvoir de l’innovation ambiante. Notre pari va croiser immanquablement un protagoniste tenant un rôle-titre dans l’actualité, l’intelligence artificielle. On lui prête toutes les vertus et tous les maléfices, par un effet de symétrie entre messianistes et catastrophistes. Or les partisans de la coolitude technologique aussi bien que les éreinteurs de l’époque et de la technique, offrent peu de prises sur ce qui s’appelle précisément le présent.
Commençons dans le Port-Royal de 1655. Comme le mathématicien Pierre de Fermat, Pascal pratique le calcul des probabilités conditionnées. Et comme ses contemporains, il est fasciné par les jeux d’argent. Les chances de gain et perte sont calculées par un ratio : le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Mais qu’en est-il si on arrête la partie en cours, comment répartir équitablement les gains avant la fin du jeu ? Si ce jeu représente une vie individuelle, il n’y a qu’une seule certitude : elle s’arrêtera.
Dans la langue prodigieuse de Pascal, cela donne ceci : « Examinons ce point et disons : Dieu est ou il n’est pas ; mais de quel côté pencherons-nous ? La raison n’y peut rien déterminer […] Il faut parier. Cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqué. Lequel prendrez-vous donc ? […] Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout, et si vous perdez, vous ne perdez rien ; gagez donc qu’il est sans hésiter ! ». Voilà donc une matrice à quatre entrées. Si Dieu existe, le croyant gagne l’infini et l’incroyant perd tout, car il n’aura pas vécu en chrétien. Si Dieu n’existe pas, le croyant obtient le néant, et l’incroyant, aussi. Le pari est avant tout une théorie de la décision : l’argument massue n’est pas tant l’existence ou la non-existence de Dieu que l’injonction urgente : vous êtes embarqués, vous devez parier.
Un saut dans le temps, nous sommes cette fois en Suisse, à Sils-Maria dans la vallée de l’Engadine, à la fin du XIXe siècle. Nietzsche a quitté ses fonctions de professeur à Bâle et il se retire l’été avec ses malles remplies de livres dans une chambre à peine chauffée. Aujourd’hui, les touristes piétinent dans la petite auberge Dourisch, intitulée somptueusement « Musée Nietzsche » avant éventuellement d’aller prendre le thé au Waldhaus Hotel, à la sortie du village. Août 1881 est la saison de la révélation de l’éternel retour au bord du lac de Silvaplana, un site qui ravit littéralement Nietzsche. Cette doctrine de l’éternel retour, présente dès le Gai savoir, sera au cœur de son Zarathoustra :
« Et si, un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta suprême solitude et te disait : “Cette vie, telle que tu la vis maintenant, telle que tu l’as vécue jusqu’ici, il te faudra la vivre encore une fois et encore d’innombrables fois; elle ne comportera rien de nouveau ; tout au contraire ! Chaque douleur, chaque plaisir et chaque pensée, le moindre soupir, tout de ta vie reviendra encore, tout ce qu’il y a en elle d’indiciblement grand et d’indiciblement petit, tout reviendra, et reviendra dans le même ordre, suivant la même succession… Et également cette araignée reviendra aussi, et ce clair de lune entre les arbres, et cet instant, et moi-même ! L’éternel sablier de l’existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières !” ».
Dans la philosophie nietzschéenne du devenir, de la non-fixité, du renversement de toutes les valeurs, la révélation de « l’éternel retour » reste insolite et improbable. Cette pensée de tous les courages consiste au fond à dire « oui » à chaque instant et à l’existence tout entière. Acquiescer à la totalité de ce qui nous arrive, à la totalité du monde et repousser par la même occasion, les hallucinés des arrière-mondes, qui sont légions.
Troisième saut, cette fois dans la Silicon Valley de la fin du XXe siècle. Le pays du post-humanisme s’adosse aux progrès technologiques, fulgurants et prometteurs, qui « augmentent » l’humain et mobilisent les firmes dominantes de la révolution numérique. Une évolution dirigée par la technique sera beaucoup plus rapide que l’évolution naturelle. Génétique, eugénisme, biotechnologie, exo-darwinisme qui externalise les moyens de l’évolution : le cortège du post-humanisme ne cesse de s’agrandir. Dans son versant pittoresque et délirant, celui du transhumanisme, se loge une obsession récurrente : l’immortalité. Tendre vers l’immortalité quitte à tout détruire de l’habitat actuel. Il y avait l’éternel retour nietzschéen, le transhumanisme rêve quant à lui, « l’éternelle sortie » de la condition humaine, et si possible en Space X. Régulièrement les tenants du transhumanisme en appellent à des moratoires de la recherche en intelligence artificielle, en fonction des avancées ou des retards des entreprises qui leur sont liées. Épargnons-nous toute citation des néo-prophètes « West-Coast », la chute serait brutale, après la langue de Pascal et de Nietzsche.
Nous vivons aujourd’hui après l’intelligence artificielle, après le post humanisme. Nous vivons après les dualités pétrifiées Nature/Culture, Faits/Valeurs, Réel/Perspectivisme. Le pari du présent et du devenir préservés n’a plus rien du pacte de la démesure de Faust : tout obtenir maintenant, quitte à tout perdre ultérieurement.
Notre postulat de départ est anthropologique et artistique, la conjonction mesurant l’enjeu : il n’y a pas de mondes nouveaux sans capacité à les habiter ici et maintenant. Les notions d’habitat et de territoire ont pris une ampleur nouvelle par les effets conjugués de l’anthropologie et de la sociologie des sciences : le territoire, plutôt qu’un lieu repérable sur une carte, s’est élargi à de nombreuses composantes humaines et non-humaines. Il est déterminé par la liste des entités dont nous dépendons, puisqu’il s’agit de faire monde avec… la particule invisible, le virus, la lisière, tel collectif, une multitude d’entités diverses. L’interconnexion est locale et mondiale, elle constitue un maillage immense. Refondé par les sciences studies, ce concept de territoire présente pourtant une lacune majeure, un oubli tonitruant, l’oubli de la création artistique et des manières de l’habiter[1]. Trop absente des discours et des désirs, cette création n’est tolérée qu’en configuration minoritaire, ainsi la performance, si mal nommée, ou la simple animation culturelle, dérisoire sur un domaine patrimonialisé.
Or la création artistique désigne précisément l’opération originale qui conçoit simultanément « l’habitat » et une manière d’habiter. Ainsi la peinture et une manière de voir, la musique et une manière d’entendre, le théâtre et une manière d’agir, la fiction et une manière de vivre, la création et une nouvelle façon de fabriquer des mondes. « Mon temps viendra » n’est d’aucun réel secours. L’artiste en éternel pionnier ? Le plus souvent, c’est l’époque qui se trouve très en retard sur elle-même. Dans ses manifestations les plus saisissantes, l’œuvre d’art agit au futur antérieur, par sa prise originale sur son propre temps. Désormais, on sait que la Florence agitée de 1300 aura été celle de l’Enfer de Dante ; désormais on sait que le rêve urbain de l’Amérique des années 20 aura résonné dans la violence ravageuse de la musique de Varèse, le compositeur français qui abandonna le Vieux Continent pour le Nouveau Monde. Chacune de ces configurations artistiques réalise l’alliance fulgurante d’un imaginaire individuel et d’un imaginaire collectif. Habiter une œuvre, c’est revoir, réécouter, revivre, ré-interpréter un monde alors même que toutes ses conditions d’émergence ont disparu. La contraction entre une aventure artistique et l’esprit du temps, est-elle bouleversée par les percées de l’intelligence artificielle?
L’intelligence artificielle bouscule les derniers bastions propres à l’humain, jusqu’à la créativité. Elle occupe les esprits et les médias car elle simule des comportements qu’on jugeait inaccessibles au fonctionnement de la machine. L’effervescence autour de l’IA générative tient à notre goût pour le faux et les Deep Fake. S’il n’est pas du tout certain qu’il existe une quelconque passion pour la vérité, la fascination pour la facticité ne fait aucun doute. Le second effet de l’IA provient de sa pénétration récente dans les foyers individuels, par l’efficience d’un système entrainé sur des données nombreuses : le succès mondial de Chat GPT auquel chacun contribue par ses usages.
Les industries culturelles font leur miel de l’intelligence artificielle par la facilité d’usage des grands modèles de langage (LLM) entrainés sur des données massives. C’est la consécration de l’hégémonie du connexionnisme. Plutôt que de générer la diversité à partir des règles, la machine apprend, expérimente, pondère à partir de la multiplicité des données. Peu importe que cette donnée soit un pixel, un son, une lettre : le connexionnisme a parachevé la transformation du monde en espace vectoriel, après avoir revendiqué, puis abandonné, l’inspiration de modèles biologiques. On mesure en effet toute la limite des analogies biologiques utilisées par l’informatique autour des « réseaux de neurone ». Un enfant expérimente la chute des corps en jetant deux ou trois fois de suite le même objet, sans requérir des données massives. En regard, et même si des recherches passionnantes envisagent une intelligence artificielle frugale, moins gourmande en données d’apprentissage et en puissance de calcul, l’apprentissage profond reste un gouffre énergétique. L’intelligence artificielle a durablement installé une immense machine inductive sur la face du globe et derrière la scène du globe.
L’un des effets majeurs de l’IA dans la créativité est la prolifération d’un casual art, un art décontracté et désinhibé pour tous et par tous, remplissant des galeries en ligne qui démultiplient les « à la manière de »… Van Gogh, Pollock, Bowie, Beethoven, Kraftwerk, moi-même comme un autre. Visiter ces laboratoires en ligne, c’est plonger dans un tohubohu où le tour de force le dispute au kitsch et à la norme. Aujourd’hui Midjourney et DallE, fers de lance du casual art, génèrent des images à la volée à partir d’une simple description textuelle. En appliquant le « prompt to image », « prompt to music », « prompt to video », le casual art perpétue une conception très datée qui veut qu’une réalisation artistique réponde toujours à un descriptif. La peinture moderne s’est émancipée dans son histoire de la dénotation et de la représentation ? La musique depuis le post-romantisme s’est débarrassée de tout argument extérieur à elle-même[2]? Peu importe, le casual art adopte une pratique ancienne, au nom d’une raison supérieure et imparable : réaliser la traductibilité totale du sensible, la similarité sans limite, réduire le divers à une équivalence.
Nous sommes de plain-pied dans l’ère de la reproductibilité, qui n’est évidemment pas née avec l’explosion de l’intelligence artificielle générative. La reproductibilité est l’activité par excellence de l’humain, il suffit de songer aux immenses galeries d’art historiques où les mêmes thèmes, les mêmes sujets ont été repris et variés inlassablement et magistralement, simultanément et successivement, jusqu’à ce qu’une ligne de fuite, un cadrage aberrant, l’intensité inattendue de la lumière, interrompent le genre, la série et notre regard.
Au commencement, la reproductibilité. Au commencement, une typologie, bien avant l’émergence d’une voix propre. Comme s’il fallait l’archive et le déchet pour que l’œuvre émerge – en quoi la galerie d’art historique s’apparente à son échelle, à la galerie de l’évolution. Avec l’intelligence artificielle, l’empire de la reproductibilité n’est plus seulement notre horizon de départ, mais un immense delta d’arrivée, renforcé par les processus génératifs. C’est ici précisément que les marchés commencent à s’alarmer des effets de leur propre productivisme.
Si le casual art met des outils à disposition de tous, si chaque récepteur est devenu de fait un émetteur, qui pourra encore habiter les œuvres accumulées ? Quelle liberté pour les appréhender, ne serait-ce qu’un instant ? Si 120 000 nouveaux titres sont distribués chaque jour sur les plateformes de streaming audio, qui aura encore la disponibilité et le désir de les entendre ? Personne sauf peut-être une IA qui les écoutera après les avoir générés… L’automatisation portée par l’intelligence artificielle libère des forces actives dans l’économie et la société, engendre de nouveaux métiers à mesure que d’autres disparaissent. Mais cette automatisation trouve sa nette limite dans l’expérience artistique, là où le productivisme forcené confine à l’inhabitable.
« Je peux tout faire » proclame haut et fort la techno-créativité ; « je ne ferai pas tout » nous dit chaque œuvre d’art qui se détermine précisément par ce qu’elle a choisi de ne pas faire. L’art consiste à remplacer la nuée et le mirage des possibles, par la force incommensurable d’une impossibilité choisie et signée ! Wagner avec sa mélodie infinie, a récusé tout l’opéra à numéros ; Rothko ne peint pas de figures humaines dans sa peinture sans bord ; Kubrick ne réalise qu’un seul film-spécimen par genre parcouru – le space opera, le film de guerre, le drame historique… Si le maître-mot de l’intelligence artificielle est bel et bien « l’apprentissage », l’acte-clé de la créativité humaine pourrait être désapprendre. Copier pour mieux désapprendre, cet acte reste très étranger à l’IA.
La créativité humaine retrouve ainsi sa pleine fonction d’antidote, comme production de rareté. Copier ? Tous les artistes le firent – Picasso aura dévoré ses contemporains comme ses prédécesseurs. Copier non pour imiter et dupliquer, mais pour étudier et objectiver une tradition afin qu’elle ne s’inscrive pas dans le métier comme simple habitude. Le désapprentissage permet de déterminer son propre espace de liberté. Imaginons donc une IA non plus seulement de simulation mais bien de stimulation. Si cette intelligence me permet de m’observer moi-même comme tendance, je pourrais tracer des chemins moins parcourus. Le premier acte du pari de l’habitabilité, c’est de miser l’apprentissage-machine en faveur du désapprentissage-humain qu’est la créativité.
Le second acte du pari consiste à apparier le plus lointain et le très proche. Imaginons par exemple une playlist intelligente qui ne recommandera plus ce que j’ai déjà consommé, par simple et stupide similarité, mais qui pointera une « population lointaine » articulée aux choix antérieurs, par une comparaison de très haut niveau. Vous aimez la musique carnatique de l’Inde du Sud, découvrez ce titre électronique immersif. Corréler des mondes séparés, sortir des assignations culturelles, habiter le lointain et patauger un peu moins dans le proche : ce programme est à la portée d’un usage éclairé et décidé de l’intelligence artificielle.
Habiter le monde, habiter l’art : notre double pari a pris son envol à partir de trois moments historiques qu’il ne s’agit pas de dupliquer mais de surmonter. Du post-humanisme, gardons l’importance de la maitrise de la technologie et l’incrédulité quant au « propre » d’un humain « éternel ». De l’éternel retour de Nietzsche, gardons l’intensité et la valeur absolue de l’instant présent. Du pari de Pascal, préservons l’injonction à choisir et à décider. Pour creuser, expérimenter, éprouver ou réfuter toute hypothèse d’un humanisme du numérique, il faut pouvoir aller du minoritaire (la création, les sciences) vers le majoritaire (les industries culturelles, les technologies), et retour. Autrement dit, circuler de la puissance du minoritaire au pouvoir du majoritaire, dans les deux sens.
Mais s’agit-il encore et toujours d’habiter les mondes, notre élan initial, ou plutôt de les hanter ? Pour refermer provisoirement cette brève traversée issue de Port-Royal, il faut prêter l’oreille à la clameur du présent et de la mémoire, à la visitation de nombreux revenants, au déphasage des temps et des époques. En 2023, le journal Le Monde sollicitait l’Ircam pour reconstituer ce que notre mémoire collective croyait connaître de première source : l’Appel du 18 juin du Général de Gaulle à la BBC au moment de la plus grande débâcle matérielle et morale. Personne ne dispose de l’enregistrement archivé de ce moment iconique et ce qu’on associe au 18 juin est en réalité l’appel du 22 juin, lancé après la signature de l’armistice par Pétain.
Comment entendre à nouveau l’Appel, à nouveau c’est-à-dire pour la première fois ? Il a fallu retrouver le message initial, à partir d’une retranscription réalisée …en allemand par les services secrets suisses à l’écoute de la BBC. La reconstitution se présente alors comme un thème musical qu’il est possible de rejouer par ses variations ultérieures. L’IA permet d’identifier les caractéristiques de la voix historique, parmi des milliers d’autres voix ; elle permet d’identifier parfaitement la voix de l’acteur, parmi beaucoup d’autres voix. L’opération permet ensuite d’habiller l’expressivité de l’acteur vivant de la voix du fantôme. Mais un message n’est pas qu’un signifiant linguistique, c’est aussi une expressivité, un rythme, le son d’une technique de studio, l’accent d’une époque.
Cette combinaison d’ingénierie et de haute-couture a fabriqué un objet dont le statut reste à définir. Une archive ? Non. Une pure fiction ? Non plus. C’est plutôt un revenant dans la mémoire collective, un artifice qui dit la vérité d’un moment historique. Lorsque l’archive s’accorde ainsi au vivant et l’interpelle, le temps semble désarticulé, déréglé, « déjointé ». The time is out of joint, le temps est sorti de ses gonds : Hamlet le proclamait déjà après la rencontre avec son spectre de père. La distinction entre vivant et non-vivant, actuel et inactuel, effectif et virtuel est minée. « Être et ne pas être », telle est la condition du spectralisme technologique et de notre présent peuplé de fantômes actifs. Ce qu’un prince mélancolique du Danemark a déclaré un jour sur la scène du Globe, l’ingénierie et l’imaginaire le réalisent aujourd’hui. C’est peut-être cela l’esprit du temps, l’esprit comme revenant.
Comment habiter le monde sans se perdre dans le labyrinthe des sources, sans subir l’autorité arrêtée du passé et du localisme identitaire ? Notre postulat de départ s’est transformé : il n’y a pas de mondes nouveaux sans capacité à les hanter ici et maintenant. Les revenants y parviennent mieux que quiconque, en se glissant entre les plis des généalogies. Ils reviennent, oui, mais, comme la voix du 18 juin, ils reviennent pour la première fois.
